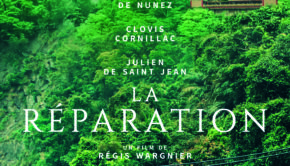The Gazer de Ryan J. Sloan
L’amnésique occupe une place à part à l’écran où il est souvent associé au film policier. La mémoire s’avère propice à des jeux infinis sur le temps qui a souvent inspiré des œuvres passionnantes. Le personnage de The Gazer est ainsi une femme en proie à une pathologie très particulière, la dyschronométrie. Cette maladie dégénérative atteint ses capacités cognitives en entraînant des conséquences d’autant plus fatales qu’elle a du mal à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Jusqu’au moment où une inconnue lui propose un marché susceptible de régler tous ses problèmes. Encore faut-il qu’elle parvienne pour cela à déjouer son pire ennemi : ce trou noir qui est en train de l’engloutir, malgré les efforts désespérés qu’elle déploie pour s’accrocher à des signes trompeurs.
Le premier long métrage de Ryan J. Sloan apparaît comme un véritable cas d’école surgi de nulle part. Il est l’aboutissement d’un itinéraire atypique comme le cinéma contemporain en dénombre trop rarement, surtout aux États-Unis où la période post- Covid 19 n’apparaît pas vraiment propice à l’audace. Son réalisateur était prédestiné à prendre la succession de son père avec lequel il a commencé à travailler comme électricien dès l’âge de 13 ans. C’était compter sans sa mère simultanément victime d’un accident grave et clouée au lit qui lui a fait partager sa passion dévorante pour le cinéma. Le passage à l’acte n’est venu qu’ensuite, quand le jeune homme et son amie Ariella Mastroianni au patronyme prédestiné se sont lancés dans l’élaboration d’un scénario en profitant de leurs loisirs, puis dans un tournage au long cours, en rassemblant une équipe de passionnés, en fonction de leurs disponibilités. Avec pour guides dans ce labyrinthe un podcast animé par le chef opérateur Roger Deakins et des mémoires de réalisateurs comme Alexander Mackendrick et Sidney Lumet qui ont nourri les compétences de cet autodidacte devenu réalisateur, producteur, scénariste, monteur et même storyboardeur de son film. Une méthode globale qui renvoie aux origines mêmes du 7e Art et a incité les deux partenaires à toucher à tout pour conserver une maîtrise absolue, devant comme derrière la caméra. Le sujet même du film s’accommodait en outre particulièrement bien de ces conditions de tournage si peu orthodoxes qui furent naguère l’apanage du cinéma indépendant rentré depuis dans le rang des Majors. Rarement sans doute un plan de travail a épousé à ce point une écriture qui tire précisément sa richesse d’une forme kaléidoscopique supposée refléter les errement d’un cerveau humain en voie de dégénérescence. Un peu comme si cette histoire avait été conçue en se référant à la courbe générée par un électro- encéphalogramme.
The Gazer évoque irrésistiblement par son sujet un modèle du genre : Memento (2000) de Christopher Nolan dont la narration reste un modèle du genre, puisque l’intrigue proprement dite progresse de façon linéaire, mais est entrecoupée de séquences qui progressent quant à elles à rebours sur le plan chronologique, pour décrire le calvaire subi par un amnésique dont la quête est entravée de mensonges par des inconnus animés de mauvaises intentions. Ryan J. Sloan et Ariella Mastroianni jouent eux aussi avec la faille de leur héroïne, sans pour autant utiliser une structure si alambiquée. Là où Guy Pearce accumulait les notes comme des pointillés éphémères vers la vérité, la pompiste aux abois de The Gazer enregistre des K7 audio et multiplie les initiatives afin de sécuriser les lambeaux de mémoire auxquels elle s’accroche désespérément, tout en entretenant une défiance obsessionnelle à l’égard de ses interlocuteurs réels ou mémoriels. L’esthétique est quant à elle indissociable de l’usage anachronique du 16mm, pour des raisons moins économiques (le numérique aurait été moins coûteux) qu’artistiques (notamment par ses options chromatiques), qui constitue un geste puissant en renouant avec une liberté dont le cinéma américain a perdu le secret. Un parti-pris qui renvoie irrésistiblement à la force brute de certains opus de John Cassavetes, l’un des rares créateurs de formes américains à avoir davantage fait école à l’international que dans son propre pays où il n’a jamais été considéré comme un prophète, sinon par quelques originaux et des francs-tireurs de moindre renom. De là à considérer Ryan J. Sloan comme son héritier et Ariella Mastroianni comme sa Gena Rowlands, il n’y a qu’un pas qu’il est prématuré de franchir, tant le film convoque de références multiples et révèle de nouvelles surprises à chaque vision.
Malgré sa sophistication plutôt bluffante, The Gazer ménage aussi de jolis moments de spontanéité qui doivent autant au jeu d’une interprète toujours sur le qui-vive et en mouvement qu’à un nombre de prises limité qui intègre les aléas du tournage en évitant le formalisme, mais mêle au réel le plus sordide un onirisme parfois “lynchien”, sous prétexte de refléter une perception faussée du temps à cheval entre deux mondes. Avec en filigrane la référence suprême que revendique ce tandem de cinéma : Burning (2019) du Coréen Lee Chang-dong pour son écriture comme pour la prestation de son interprète principale féminine. Rien n’y est jamais prévisible, sinon que Ryan J. Sloan possède bien des atouts pour faire entendre sa voix singulière avec un amour du cinéma qui dévaste tout sur son passage.
Jean-Philippe Guerand
Film américain de Ryan J. Sloan (2024), avec Ariella Mastroianni, Marcia Debonis, Renee Gagner, Jack Alberts, Tommy Kang. 1h54.