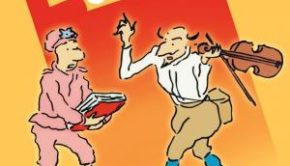Tatami de Zar Amir Ebrahimi et Guy Nattiv
Le titre de ce film a le mérite de la clarté, puisque c’est bel et bien autour d’un tatatmi, et d’une compétition sportive, que va se jouer la majeure partie de l’action. Son sujet plus profond peut se voir dans sa fabrication même, et les personnes ayant créé l’œuvre. Tatami est en effet co-réalisé, entre un cinéaste israélien remarqué pour plusieurs œuvres internationales, telles que Skin ou le récent Golda, et une actrice iranienne, Zar Amir Ebrahimi, remarqué depuis Holy Spider et exilé en France à la suite d’un scandale, pays où elle a pu reprendre sa carrière, par exemple dans Les Survivants.
Le long métrage en soi est suisse, pays neutre qui convient à un récit qui, par son mélange même de pays et d’artistes, porte une partie de son essence. Oui, Tatami sera donc effectivement un film politique, au croisement parfait des tensions entre Israël et l’Iran, sujet traité sous un angle tenant à la fois du thriller et du récit sportif.
Parce qu’il s’organise autour d’un tournoi de judo, Tatami prend donc place dans une tradition compliquée, celle du film de sport. Un genre un peu ingrat, complexe, qui piège bien des cinéastes parfois fort prestigieux (John Huston par exemple) par la grande complexité narrative et visuelle qu’impose ce genre de récit. Le film de sport confronte toujours, invariablement même, deux problématiques : celle du récit filmique en soi, de ses obligations, et celle de l’événement sportif ainsi filmé, qui ne sont pas nécessairement les mêmes et doivent ainsi cohabiter dans un espace commun qui peut vite poser un problème. Le succès de l’œuvre dépend principalement de la manière dont le cinéaste parvient ainsi à conjuguer ensemble les deux récits, celui de l’œuvre en soi (enjeu des personnages, de l’intrigue) et celui du sport mis en scène (règles sportives, suspense de la victoire, compétition). Dans le cas présent, le principe même narratif même est habile car dans un équilibre parfait entre l’enjeu sportif et l’enjeu plus classiquement dramatique. Le récit suit donc une compétition de judo féminine, et s’attarde plus principalement sur l’équipe iranienne, et sur le duo formé par l’une des favorites du tournoi et son entraîneuse, ancienne championne de cette catégorie. La détermination de la jeune judoka semble sans faille, elle commence à enchaîner les victoires, se dirigeant ainsi à toute la vitesse vers une finale qui pourrait l’opposer… à une Israélienne. Devant l’impossibilité de cette rencontre (qui admettrait ainsi, de la part de l’Iran, la validité et l’existence de l’Etat d’Israël), le gouvernement iranien agit et lui ordonne d’abandonner. La jeune femme refuse, continue de gagner et de se rapprocher de la finale, alors que les pressions s’accélèrent et se transforment, tout autour d’elle, en menaces.
Ce mélange entre politique et film sportif n’est pas si rare que cela, sans doute par la manière dont le sport mêle souvent des enjeux nationaux, identitaires, à la compétition, et permet donc d’interroger des problématiques idéologiques sans lourdeur, presque avec légèreté. Le sujet même de l’Iran et de la place de la femme dans sa société a déjà été évoquée précisément dans ce cadre, il y a quelques années avec La Permission, où le capitaine de l’équipe de football féminine ne pouvait quitter le pays (pour disputer un tournoi) à cause de la permission refusée de son mari. Les deux œuvres, malgré de nombreuses différences, tournent néanmoins autour d’un point central similaire : le sport en tant que moyen d’émancipation, moyen finalement rattrapé et diminué par la société iranienne. Dans les deux cas, l’entêtement de l’héroïne à continuer malgré les pressions dépassent bien évidemment largement le cade de la compétition sportive, et proviennent d’une envie d’exister, fatalement contrecarrée. Ce système donne ainsi du sens, mais se révèle également très malin d’un point de vue narratif, et même visuel. Les chorégraphies des matchs de judo deviennent ainsi un symbole paradoxal. Chaque combat est un signe de la rage de vaincre de l’héroïne, de sa volonté, et chaque victoire rapproche néanmoins d’une catastrophe qui apparaît comme de plus en plus inévitable. Le récit sportif se pare très littéralement des accents de la tragédie, d’un malheur qui surgit à la fois d’une puissance supérieure (l’Etat et ses représentants multiples) mais aussi des actions de la protagoniste, de ses choix propres. La rage de vaincre, opposée à l’autoritarisme de l’Etat iranien, illustré par des affrontements sur le tatami qui peuvent ainsi jouer sur deux tableaux de suspense différent.
Sous cet angle, il y a au cœur de Tatami un vrai mélange des genres, mais qui tient davantage du rapprochement avec un registre bien connu et apprécié par les afficionados du Hollywood des années 1970, le thriller politique, à tendance paranoïaque. Et, à ce niveau, tout y est. Dans une belle et noble tradition, se rattachant à des classiques tels que A Cause d’un assassinat, la réalisation suit à la trace l’héroïne, s’attache au moindre de ses pas et retranscrit entièrement le monde selon son regard, ses angoisses. Et ce monde est bien évidemment coloré par la peur d’un Etat totalitaire, tentaculaire, dont les représentants sont partout, postés au moindre tournant, menaçant et omniprésents. Comme dans Les Trois Jours du condor, les envoyés du pouvoir envahissent le cadre, se rapprochent progressivement, et créent une méfiance qui contamine la perception de l’héroïne, ses rapports avec les autres, son entraîneuse en premier lieu. Cette dernière apparaît d’ailleurs progressivement comme le point central du récit, et de ses enjeux. Autant sa protégée est d’un bloc, et se caractérise telle une force inamovible, liée à une rage qui semble tout écraser, y compris les conséquences de ses actions, autant sa coach semble détentrice d’une histoire plus longue et contrastée, portant en elle des contradictions dans lesquelles s’imprime le propos. Il apparaît en effet qu’elle a été dans la même position, il y a des années, et qu’elle a cédé aux pressions de l’Etat, mettant fin à ses rêves olympiques, mais s’assurant une carrière plus longue en Iran. Cette notion d’histoire qui se répète est centrale, car c’est précisément dans cette idée de boucle perpétuelle, dans laquelle l’oppression et la soumission se reproduisent périodiquement, que l’engagement idéologique de Tatami est le plus clair. L’histoire ici racontée n’est que le maillon d’une chaîne plus vaste, et le briser devient un enjeu plus large, à l’échelle de l’Iran et de son système politique patriarcal.
Cette rupture finale, même si elle est satisfaisante pour le spectateur, n’est pas vraiment le point fort du film. Le dénouement se révèle un peu lourd dans l’écriture. C’est un problème récurrent des œuvres engagés, elles peuvent se révéler très maladroites lorsqu’elles rentrent dans l’explicite. Mais ce dernier acte ne peut gâcher la réussite globale de Tatami, la manière virtuose dont il mêle les fils du thriller, du drame sportif, et du récit politique, chacun de ses points parvenant à compléter et à renforcer l’autre. Quelles forment peuvent- elles être employées pour raconter l’oppression idéologique, la peur ? C’est une vieille question, à laquelle bien des cinéastes se sont attelés. Tatami n’est pas parfait, mais pose au moins des solutions pertinentes à ces anciennes interrogations.
Pierre-Simon Gutman
Film israélo-iranien de Zar Amir Ebrahimi et Guy Nattiv (2024), avec Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Ash Goldeh. 1h43.