Numéro 709 – La Petite Lili de Claude Miller

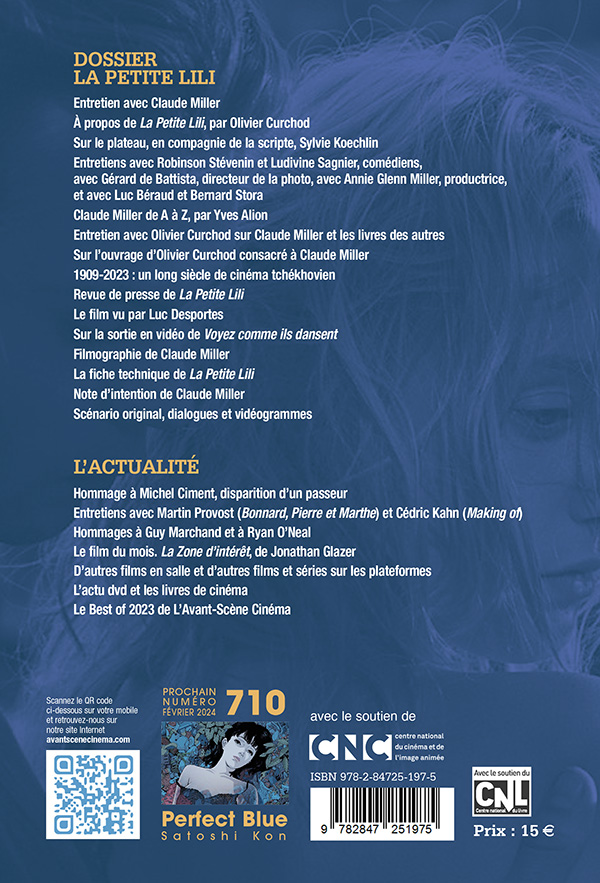
Dossier La Petite Lili de Claude Miller
Entretien avec Claude Miller
Cet entretien avec Claude Miller a été réalisé à chaud, au moment de la sortie du film et publié une première fois dans les pages d’actualité du numéro 524 de l’ASC, consacré à Van Gogh, de Maurice Pialat. Vingt ans se sont écoulés, La DV a quitté le cœur des débats et Claude Miller, hélas, n’est plus. Mais ce que nous dit le cinéaste sur ceux qui vivent du cinéma, mieux, qui vivent le cinéma, n’a pas pris une ride. Il aurait été stupide, absurde et même criminel de ne pas reprendre les propos du signataire de La Petite Lili dans le dossier de ce numéro…
PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION
La Petite Lili est l’adaptation d’une pièce de Tchekhov, mais on a le sentiment que vous vous êtes emparé d’un grand classique pour en faire un film autobiographique. Le rapprochement est d’autant plus tentant que vous êtes vous-même cinéaste et que les personnages du film sont confrontés à des questions que vous n’avez pas pu ne pas vous poser…
Claude Miller : J’espère que le propos du film est plus universel que cela. C’est l’essence même de la jeunesse, quel que soit le milieu social et culturel, de se montrer intransigeante, absolue, radicale. C’est le contraire qui serait inquiétant. Parce que devant la confusion du monde, il est naturel de chercher des certitudes. C’est le point commun de La Mouette dans le domaine du théâtre et de La Petite Lili dans celui du cinéma que de traiter des rapports de pouvoir entre les générations. Car tout se rapporte à des rapports de force, d’identité. Chaque génération essaye d’affirmer son identité, chacun essaye d’être aimé pour ce qu’il est, y compris pour ses défauts. Dès lors, que le film soit autobiographique est une évidence. Les personnages font le même métier que moi, ce qui m’a permis de témoigner de ce que j’ai vu et ressenti depuis des années.
Avez-vous effectué ce parcours-là, de l’intransigeance et la radicalité à une approche plus bourgeoise du cinéma en passant de La Meilleure façon de marcher à La Petite Lili ?
C.M. : Ce n’est évidemment pas si simple. De même que le clivage entre mes deux personnages, Brice et Julien, n’est pas aussi tranché que cela. Parce que cinq ans après leur affrontement, Julien fait un film que l’on ne voit pas mais dont on se doute qu’il ne correspond pas à ce qu’il proclamait vouloir faire cinq ans plus tôt. Certains m’ont reproché de le faire travailler en studio. Comme si le fait de travailler en studio signifiait que l’on donne dans le commercial, à l’opposé d’une soi-disant spontanéité qui serait l’apanage de l’extérieur.
On voit bien quand même que le film de Julien est plutôt naturaliste, avec des dialogues empruntés à sa vie et à ses souvenirs alors que le petit film qu’il avait fait à l’île aux Moines donnait davantage dans l’expérimental…
C.M. : Par force. Quand on tourne en DV, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. Mais j’ai pris soin, autant dans le petit film de l’île aux Moines que dans le film qu’il tourne à la fin, de ne porter aucun jugement esthétique. Quant à dire que j’étais Julien au moment de La Meilleure Façon de marcher et Brice aujourd’hui, c’est aller un peu vite en besogne. La pensée de Brice correspond à un état d’esprit dont j’espère malgré tout qu’il n’est pas le mien : il est désenchanté. Ce qui n’empêche pas son savoir-faire, son habileté. J’ai essayé de le montrer blessé : il y a certainement une voix en lui qui lui dit qu’il a trahi les rêves de sa jeunesse. C’était d’ailleurs un peu la clé que l’on s’est donnée avec Bernard Giraudeau pour définir le rôle. Moi, je ne ressens pas les choses de cette manière.
Est-ce à dire que l’enthousiasme ne vous a pas quitté ?
C.M. : Disons qu’il a changé de nature. J’ai toujours la même fièvre, la même anxiété, la même angoisse, les mêmes doutes. De l’enthousiasme, je dirai que j’en ai davantage aujourd’hui qu’à l’époque de La Meilleure Façon de marcher, parce qu’à ce moment-là j’avais tellement peur d’être un imposteur, de ne pas être à la hauteur de mes rêves et de mes amours de cinéphile. Quand je commence un film, je suis beaucoup plus vaillant que je ne l’étais il y a trente ans. Bien sûr j’avais à ce moment-là déjà travaillé dans le cinéma, comme assistant, mais ce n’était pas la même chose. Le metteur en scène est sous le feu des projecteurs, il est sur le devant de la scène. On a beau avoir à peu près tout fait auparavant, quand il faut se jeter à l’eau, on est plus mort que vif. Aujourd’hui les doutes subsistent, mais j’entre plus facilement dans le bain.
Le film insiste sans doute beaucoup sur l’opposition entre les deux personnages, parce que les nécessités de la narration vous obligent à aller à l’essentiel, à trancher.
C.M. : C’est évidemment tranché, mais subsiste malgré toute une part d’ambiguïté. Nombre de spectateurs aurait voulu que je prenne clairement parti pour l’un ou pour l’autre. Je ne suis heureusement pas prêt à dissiper le malentendu.
Pour le spectateur, le film s’apparente à un test du Rorschach, qui permet de se voir en jeune idéaliste fougueux face à un vieux con désabusé ou d’affirmer sa maturité face à un roquet brouillon…
C.M. : Tout à fait. Je parlais récemment à un ami qui a l’habitude de ne pas me faire de cadeau. « C’est trop facile de dire que tout le monde a ses raisons, me disait-il. Tu es comme un petit bouchon, le bouchon renoirien qui se laisse flotter au gré des circonstances.» Je lui ai répondu : « Tu présupposes que je suis fait en liège. Mais si j’étais en éponge ? Je flotterais tout autant mais, par capillarité, par empathie, je m’imbiberais de tout ce que mes personnages ressentent, de leurs souffrances. C’est ça mon boulot…»
Et si déboule un personnage pour lequel l’empathie est difficile, voire interdite ?
C.M. : Dans ce cas, je ne le fais pas vivre. Mais si le personnage a une attitude révoltante, dérangeante, ce qui est toujours le cas dans mes films, je m’y intéresse d’autant plus. C’est dans La Classe de neige que le problème s’est posé avec le plus d’acuité. J’étais forcé d’avoir une certaine dose d’empathie, de compréhension pour un affreux criminel pédophile. Cela n’a pas plus à tout le monde…
La DV est depuis plusieurs films au centre de vos préoccupations. Peut-on aller jusqu’à dire qu’elle est synonyme de liberté ou même d’aventure (cf. La Chambre des magiciennes), qui s’affranchit des contraintes d’un cinéma plus traditionnel (cf. L’Accompagnatrice) ? Autrement dit, la DV est-elle un Viagra esthétique qui redonne une nouvelle jeunesse au cinéma ?
C.M. : C’est aux observateurs et aux critiques de le dire. En ce qui me concerne, c’est vrai que la DV me donne de nouveaux désirs de cinéma, comme un dessinateur à qui l’on offre de nouveaux crayons. En ce qui concerne La Petite Lili, c’est une autre nouveauté, puisque le film que Julien présente au début est en DV. Parce que je ne voyais pas comment il aurait pu faire autrement. Mais La Petite Lili a été tourné en HD (haute définition), puis reshooté en 35 mm. Comme l’ont été auparavant Vidocq, L’Auberge espagnole et Stupeur et tremblements. Je l’ai fait pour des raisons économiques, j’avais du mal à trouver le budget dont j’avais besoin. Au final, l’économie est de 30%. Je ne crois pas que le film en pâtisse. Même les purs et durs du 35 mm le concèdent.
La DV peut-elle être comparée en termes de liberté à ce que la Nouvelle Vague a pu représenter par rapport au « cinéma de qualité française » ?
C.M. : J’avoue que depuis La Chambre des magiciennes, depuis qu’il y a eu ce remue-ménage autour de plusieurs cinéastes travaillant en DV, j’ai été un peu déçu par le résultat. Je m’attendais à plus, à une plus grande liberté des auteurs, à ce que les jeunes adoptent plus facilement ce format, comme la Nouvelle Vague l’avait fait avec les caméras légères pour des raisons économiques. Je suis un peu déçu au bout de cinq ans que la DV n’ait pas fait école, n’ait pas créé quelque chose de spécial. Comme si tout à coup, les raisons étant que l’industrie n’ait pas vu cette innovation d’un bon œil, les jeunes voulaient quand même tourner en 35 mm pour avoir davantage l’air de professionnels. Je le regrette un peu. La Nouvelle Vague avait suscité l’envie de certains films qui n’auraient pas existé sans elle. Il n’en a pas été de même avec la DV. Et aujourd’hui, Vinterberg tourne le dos au dogme pour faire un film ultra-léché. C’est peut-être un signe.
Comment jugeriez-vous le film expérimental de Julien, avec les yeux de Mado, sa mère, qui le dénigre, ou avec ceux de Jeanne-Marie, qui l’idolâtre ?
C.M. : J’espère, ni l’un ni l’autre. Pour le peu que l’on voit de ce film, je me suis amusé à le réaliser en prenant bien soin de ne pas être sarcastique, parodique ou condescendant. J’ai essayé de filmer Lili comme si j’avais été amoureux d’elle. Je crois qu’elle est belle, fraîche et magique dans le petit bout de film de Julien. J’ai essayé d’être lyrique et poétique, en essayant de ne pas être poéteux. C’est vrai que le film de Julien est un exercice de style. Mado parle d’un « petit Bergman de province ». Je pencherais plutôt pour une sorte de Philippe Garrel première manière, celui de La Cicatrice intérieure [photo ci-dessous]. On m’avait conseillé de ne pas montrer le film de Julien : je crois que cela aurait été une lâcheté. Si Mado est insupportable avec son fils, elle l’aurait été quels que soient le style et la qualité du film. Mado est une femme de 45 ans, fragile comme une actrice, qui voit arriver des comédiennes plus jeunes dans le métier et qui sent son amant lui échapper… Ceci explique son attitude odieuse.
On pourrait jouer aux portraits chinois en se posant la question des films qui correspondent à chacun des personnages. Qui est Bergman, qui est Max Pécas ?
C.M. : Si Julien est Garrel, Brice n’est absolument pas Max Pécas. Je le vois davantage comme étant l’équivalent d’un cinéaste comme Pierre Granier-Deferre, qui est pour moi un metteur en scène de qualité. Jamais je ne sous-entends que Brice est un mauvais cinéaste.
Et parmi les personnages, quel est celui qui est le plus Miller ?
C.M. : Peut-être Simon, le personnage interprété par Jean-Pierre Marielle ; sans doute Lili dans la dernière partie du film. Je les rejoins sur l’addition qu’il faut payer, sur la rançon que l’on doit à la renommée. Simon est naturellement au-dessus de la mêlée, et en même temps il fait preuve d’une grande bienveillance.
Le film pose le problème de la sincérité des sentiments. Quand le succès se pointe, on se demande parfois quelle est la qualité des sentiments que les autres vous portent : est-on aimé pour ce que l’on est en profondeur ou pour l’image que l’on projette ?
C.M. : Je vois ce que vous voulez dire. Mais pour moi c’est un faux débat, un leurre. Parce que l’on est le tissu de tout cela : l’image que l’on projette ne nous est pas extérieure, elle est constitutive de ce que nous sommes. On ne peut pas partager. Les personnages du film sont soumis à des enjeux de désir. Mais si Brice n’était pas cinéaste, il ne séduirait pas Lili. Mais il ne serait pas non plus l’amant de Mado et il ne serait d’ailleurs pas présent à l’île aux Moines. Donc la question ne se poserait pas. On n’est jamais hors du monde, sans attaches. On est déterminé par notre relation aux autres.
La pièce de Tchekhov est-elle un prétexte ou est-elle porteuse d’une petite musique qui vous touche particulièrement ?
C.M. : Ce qui me touche chez Tchekhov, c’est qu’il a une grande compréhension des faiblesses des uns et des autres. Mais j’ajouterai : comme tout le monde. Je n’ai pas de relation particulière avec son théâtre. Mais quand il m’est arrivé par le plus grand des hasards de relire La Mouette, j’ai eu une espèce de flash, et je me suis dit : « C’est moi ». C’est du théâtre mais cela pourrait être du cinéma et se passer aujourd’hui. Ce seraient les mêmes enjeux, les mêmes rapports de pouvoir et de désir, la même volonté d’affirmer son identité à travers les générations. Je me suis dit : « Il y a là un film, un film dont je peux parler parce que c’est ce que je vis… » À partir de là, ce n’était plus le désir de Tchekhov, mais celui bien précis d’adapter La Mouette pour parler du monde du cinéma. Mais il est arrivé ce qui survient à la plupart des livres que j’adapte, même si cela peut paraître un peu irrespectueux : après deux ou trois mois de travail sur un scénario, je range le livre en haut d’une armoire et je ne le reprends plus. Au final il y a très peu de mots de la pièce qui soient dans le film. Parce que la langue de Tchekhov est un peu surannée. Ce qui m’amusait c’était de faire parler les personnages avec des mots d’aujourd’hui.
Le film semble poser la question de la frontière qui sépare le compromis et la compromission. Les personnages sont parfois en équilibre sur ce fil. Julien, qui se veut l’ennemi du compromis va finir par récupérer par opportunisme dans ses dialogues ce que Lili lui dit au moment où elle-même fait semblant d’être sincère…
C.M. : C’est humain. Je ne vois pas en quoi le fait de pomper la vie pour la réinjecter dans une œuvre relève de la compromission. C’est au-delà du bien et du mal. Je ne porte pas de jugement moral là-dessus. Il nous arrive tout le temps d’utiliser dans un film des choses que l’on a vues, des choses que l’on nous a dites, y compris des choses qui ont à voir avec l’existentiel ou l’intime. On me parle souvent de La Nuit américaine, puisque j’avais participé au tournage de ce film. Rappelez-vous : le problème se posait déjà. Quand Jacqueline Bisset dit quelque chose à Truffaut sur son mari, elle le retrouve le lendemain dans son dialogue… Encore une fois, le metteur en scène est une éponge, et le cinéma c’est la vie.
Le cinéaste est dans une situation privilégiée par rapport au plâtrier ou au notaire parce que les sentiments sont son matériau. Il lui est plus facile d’avoir des relations plus personnelles avec ceux qui partagent son dessein…
C.M. : Je vois deux questions dans cette remarque. C’est vrai que nous sommes privilégiés. Parce que notre travail est aussi une psychothérapie, une catharsis, une purgation. Quand Julien expose dans un film cinq ans après les faits les enjeux et les personnages de sa jeunesse, allant jusqu’à imaginer son propre suicide pour culpabiliser sa famille, il le fait parce que c’est un besoin. C’est vrai que c’est un privilège de pouvoir transformer ses souffrances en matériau utile à notre travail. L’autre question porte sur les rapports que nous entretenons avec ceux qui participent au film, notamment les comédiens. C’est vrai que faire des films, c’est un drôle de métier. Parce que le rapport du metteur en scène avec les autres, c’est un rapport de séduction. On doit séduire l’autre sur les plans affectif, intellectuel, érotique. Est-ce réellement un privilège ? Je ne sais pas. Il faut faire avec. Il ne faut pas que cela tourne au drame. Un tournage est une bulle, mais qui a une fin, comme des vacances dans un club. Les amours de tournage sont comme des amours de vacances : on est appelé à se quitter après avoir vécu des choses intenses. Cela est vieux comme le monde. Molière et Madeleine Béjart ne me contrediront pas.
Le film a une dimension faustienne : Lili et Julien vendent un peu leur âme pour être en haut de l’affiche, et ils signent avec leur sang…
C.M. : On ne sait rien des difficultés de Julien pour monter ce premier film. Étant le fils de Mado, actrice célèbre, on peut penser que cela a été un peu plus facile que pour un autre… Mais rien ne dit qu’il a vendu son âme au diable. N’oublions pas que le temps est terriblement violent, brutal. J’ai essayé de le montrer en pratiquant une cassure de cinq ans entre les deux parties du film. Certains me l’ont reproché. Mais je crois que cette période de cinq ans, c’est souvent le temps de la guérison d’une dépression, d’une rupture amoureuse… Cinq ans, c’est long quand on les vit seconde par seconde. Mais avec le recul on se dit que c’est brutal. On a changé physiquement, on peut se parler alors que ce n’était pas possible. Moi, cela me bouleverse. J’ai voulu montrer le temps qui passe à la fois comme douleur et comme antidote.
Les retrouvailles faussement dépassionnées de Julien et Lili font penser à l’épilogue de La Fièvre dans le sang…
C.M. : J’ai effectivement beaucoup pensé à ce film de Kazan pour terminer La Petite Lili. Surtout pour la violence de la métamorphose des personnages. Pour moi c’était une façon de rendre hommage au poème auquel le film fait allusion dans son titre original, qui nous parle de la splendeur de l’herbe. Une façon de revenir sur la nostalgie de l’enfance et du temps qui ne revient pas. Le temps écoulé, même s’il était difficile, plein de souffrance, de névrose, de violence, nous est cher. Il y aura toujours dans l’espace laissé béant par le temps la place pour un regard nostalgique sur nos années fiévreuses… n
PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION













