Numéro 688 – Benjamin, ou Les Mémoires d’un puceau de Michel Deville

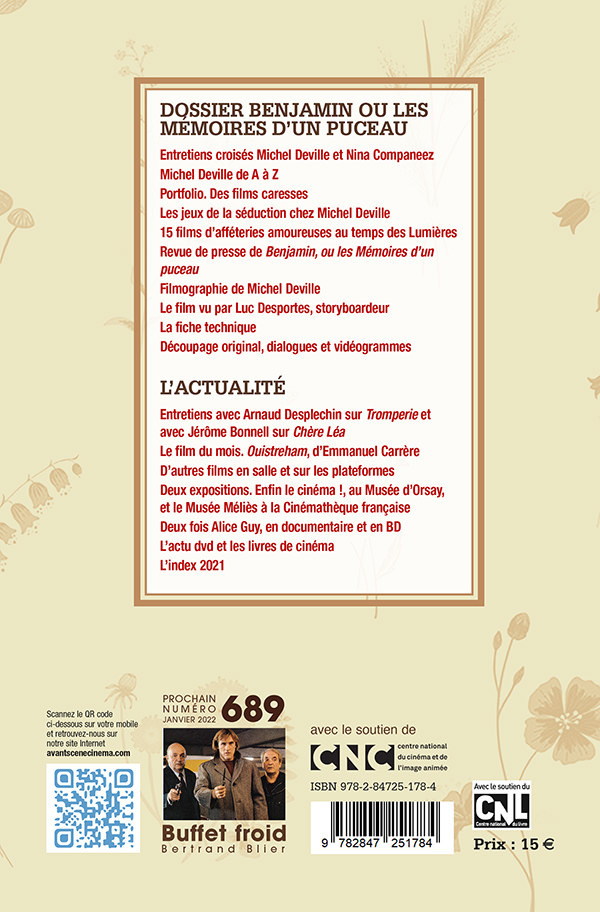
Pour commander, cliquez ici
Dossier Benjamin, ou les Mémoires d’un puceau de Michel Deville
Michel Deville de A à Z
Comme nous l’avions fait auparavant avec Philippe Lioret, Pascal Thomas, Jean-Pierre Améris, Benoit Jacquot, Emmanuelle Bercot, Olivier Assayas, Jérôme Bonnell, Robert Guédiguian, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Jean-Jacques Annaud, Bertrand Tavernier, Paul Verhoeven, Dino Risi, Christian Carion, Lucas Belvaux, Stéphane Brizé, Jean-Loup Hubert, Costa-Gavras, Agnès Varda, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Jean-Paul Rappeneau, Gérard Oury, Patrice Leconte, Emmanuel Mouret, Henri Verneuil ou Denys Arcand, c’est par vingt-six petites touches successives que nous nous proposons de brosser le portrait de Michel Deville, vingt-six flashs impressionnistes pour éclairer une œuvre plus éclectique qu’un premier regard ne pourrait le laisser penser, mais toujours délicate, sensuelle, pétillante.
PAR YVES ALION
A comme Auteur
En France, la politique des auteurs a longtemps donné le la en termes de critique cinématographique. Et Michel Deville est contemporain, et même à bien des égards assez proche de ceux qui l’ont portée au pinacle, les cinéastes de la Nouvelle Vague. Il se garde pourtant de se revendiquer comme auteur, se considérant à l’instar d’Édouard Molinaro (dont les films entretiennent une certaine parenté avec les siens) plutôt comme un artisan, et même un « bidouilleur ». C’est tout à son honneur et nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître le prestige de l’artisan. Pour autant nous ne nous résignons pas à jeter la notion d’auteur avec l’eau du bain. Si les films de Michel Deville sont parfois formellement ou thématiquement assez déconcertants pour ceux qui n’auraient vu que Benjamin ou L’Ours et la Poupée, se dégage néanmoins un parfum entêtant de toute son œuvre, que les lignes qui suivent vont tenter de définir plus précisément.
B comme Baisers
On se caresse à tous bouts de champs (et contrechamps) dans les films de Michel Deville. Et nous n’avons pas pu résister à l’idée d’en constituer un portfolio (voir pages 22 à 27). Mais on s’embrasse également beaucoup. Sans doute le cinéma de Deville est-il obsédé par ce qui se passe entre un homme et une femme (et parfois deux femmes, plus rarement deux hommes) quand le désir s’en mêle, s’emmêle. Mais il va de soi que chaque baiser est particulier, qui raconte (parfois en mentant) l’émotion dont il se veut l’écho. Il est des baisers sages, des baisers fougueux, des baisers sensuels, des baisers désespérés. Le projectionniste de Cinéma Paradiso, travaillant pour la paroisse, avait entrepris de couper toutes les scènes de baisers des films qu’il projetait. Pour en faire un montage bouleversant, en cachette du public. On pourrait également constituer un joli montage de ceux qui ponctuent l’œuvre de Deville…
C comme Comédiens
Dire que les cinéastes ont une relation privilégiée avec les comédiens revient à enfoncer tout un couloir de portes ouvertes. Mais il est évident que certains metteurs en scène chouchoutent ceux qui donnent corps à leurs images plus que d’autres. C’est le cas de Michel Deville, qui n’a jamais cessé toute sa vie durant de fréquenter les théâtres (et de voir des films) pour reconnaître ceux qui pourraient le cas échéant donner quelque couleur à son ouvrage. Au final, si certains comédiens se sont retrouvés plusieurs fois sur le chemin de ses plateaux, il faut lui reconnaître un certain éclectisme, comme s’il se régalait par avance de travailler avec telle ou tel. Sa gourmandise du jeu des autres lui fait ne pas rater la moindre inflexion, la plus petite mimique, lui interdisant de se réfugier derrière le combo (a fortiori quand celui-ci n’existait pas encore). Chantre de la précision horlogère, il n’a jamais, paradoxalement, été de ceux qui faisaient refaire les prises jusqu’à épuisement. Une préparation minutieuse et le choix exigeant de ceux qui prêtaient leur corps et leur visage aux personnages ayant rendu cette éventualité sans objet.
D comme Decoin
Les cinéastes de la Nouvelle Vague se targuaient de ne jamais avoir été assistants. Mais nombre de leurs contemporains, de Costa-Gavras à Louis Malle en passant par Claude Sautet ou Georges Lautner sont passés par la case de l’assistanat en tirant bien souvent des enseignements qui leur ont mieux que profité. C’est le cas de Michel Deville qui présente néanmoins un profil assez original, puisqu’il n’a pour ainsi dire travaillé qu’avec un seul homme : Henri Decoin. Pendant près de six ans, sur Les Amants de Tolède (1952), Dortoir des grandes (1953), Les Intrigantes (1954), Secrets d’alcôve (1954), Bonnes à tuer (1954), Razzia sur la schnouff (1955), L’Affaire des poisons (1955), Le Feu aux poudres (1956), Tous peuvent me tuer (1956), Charmants Garçons (1957), La Chatte (1958). Un joli palmarès, rencontrant pour l’occasion plus d’une star qu’il invitera ensuite sur ses plateaux (telle Françoise Arnoul). Même s’il a dû regretter d’arriver un poil trop tard pour être de l’aventure de La Vérité sur Bébé Donge !
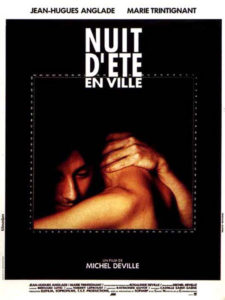 E comme Effeuillage
E comme Effeuillage
D’aucuns argueront sans doute que le regard de chacun est différent de celui de son voisin en matière d’érotisme, et même (ce qui n’est pas niable) que certains peuvent être choqués par ce qui paraîtra tellement anodin à d’autres, mais nous n’en démordrons pas : l’œuvre de Michel Deville est objectivement la plus érotique de tout le cinéma. Nul autre que l’auteur de Benjamin n’a en effet son pareil pour suggérer, pour isoler un regard fiévreux, pour nous faire caresser du regard un sein qui pointe ou une jambe qui se dénude. Il faut d’ailleurs aussitôt préciser que le charme des hommes a tout autant été mis en lumière que celui de la gent féminine. Il arrive néanmoins que les corps soient davantage exposés : Christophe Malavoy et Nicole Garcia dans Péril en la demeure, Jean-Hugues-Anglade et Marie Trintignant dans Nuit d’été en ville (entre autres) ne cachent rien de leur(s) charmes(s). Mais le regard de Deville ne suscite aucune gêne. Son amour de l’amour est sans malentendu. Même quand les desseins de ses personnages sont loin de leur valoir absolution.
F comme Flamme
À l’instar de celle des Jeux Olympiques ou de sa consœur de l’Arc de Triomphe, la flamme qui brûle au cœur des films de Michel Deville jamais ne s’éteint. Tant la passion amoureuse, y compris quand elle se mâtine de frustration ou de perversité est omniprésente. Comme si notre homme n’avait jamais renoncé à son adolescence, à cet âge où il n’est pas raisonnable de laisser trop de place à la raison. Les flammes les plus belles ne sont pas toujours celles qui font feu de tout bois. Et il n’est pas déraisonnable d’aimer tout autant (et même davantage) la flamme noire qui consume le cœur des deux amants empêchés de Raphaël que celle dont la clarté bondissante éclaire plusieurs scènes plus frivoles de Benjamin.
G comme Glace
Il arrive que le feu côtoie la glace qui se mettent mutuellement en valeur. Michel Deville semble comme fasciné par ces élans qui se retiennent. Dossier 51 semble vraiment en marge de l’œuvre du cinéaste. Mais à y regarder de plus près il existe des expressions du désir, des simulacres de possession, des manipulations glaçantes. Que l’on retrouve dans d’autres films dont le cadre semble plus directement en adéquation avec l’univers du cinéaste. Péril en la demeure, Eaux profondes… Ce dernier étant adapté d’un roman de Patricia Highsmith, dont toute l’œuvre (L’Inconnu du Nord Express ou Plein Soleil en témoignent) flotte entre deux eaux et distille un malaise durable.
H comme Haikus
Michel Deville ne se contente pas de cosigner les scénarios de ses films, il aime bien, de temps en temps, écrire un recueil de poèmes mutins, comme des haïkus du temps présent qui dénotent à chaque fois son plaisir des mots. Nous serions bien cruels de ne pas vous en offrir un, qui a pour titre Ecclesiastisme...
Suppositionnons un instant
Que l’évêque de
Pont-L’Évêque
A trop d’abbés dans son giron.
Et maintenant
Hypothésons
Qu’un pauvre évêque de
Corrèze
Manque d’abbés dans son diocèse.
Pas de problème
En vérité :
Notre évêque numéro un,
Pour une poignée de dollars,
Cède un abbé (Au hasard)
Au deuxième,
C’est enfantin,
C’est l’abbé cédé du métier.
I comme Imaginaire
Les films de Michel Deville sont des rêveries, rien ne leur est plus étranger que la rudesse du quotidien. Leurs personnages ne s’encombrent que très marginalement de soucis matériels, seuls les tracas de l’amour peuvent les terrasser… ou leur permettre de s’envoler. L’imaginaire est chez le cinéaste une terre habitée, quitte parfois à ce que les films se dépouillent d’une trame aux rebords trop affirmés. Le Voyage en douce, La Femme en bleu, La Lectrice explorent sans ambages cette part de nous-mêmes qui laisse l’esprit flotter au rythme des fantasmes. Et Benjamin n’est-il pas lui-même le bénéficiaire d’une éducation sentimentale (et charnelle) dont tout adolescent normalement constitué peut rêver à satiété ? Mais c’est Le Paltoquet qui rend compte avec le plus de fidélité de l’imaginaire devillien, multipliant les situations absurdes, les coqs à l’âne inattendus, les glissements narratifs, les clins d’œil. S’il est un film inclassable dans l’œuvre du cinéaste, c’est bien celui-ci, serti au cœur d’un théâtre de l’absurde qui rechigne à se laisser dompter.
J comme Jongleur
Ce qui frappe en premier lieu quand on voit un film de Michel Deville, c’est la précision, parfois la préciosité des éléments qui en composent la matière. Les mots sont élégants, les lumières sont belles, les femmes et les hommes à l’image le plus souvent désirables. Les cadres, les mouvements de caméra, le montage donnent dans la dentelle. On a le sentiment que le cinéaste a dans une vie antérieure été équilibriste (comme le sera Raphaël dans le film auquel il a donné son nom) ou mieux, jongleur. Il possède une dextérité qui nous laisse pantois, multipliant les calembours visuels et les clins d’œil comme des apartés au public, affichant une liberté dans son montage que beaucoup doivent lui envier, se saisissant d’une idée apparemment futile pour lui donner une ampleur inattendue, pratiquant des marabouts de ficelle de cheval d’une fluidité étonnante qui ne sont que la traduction cinématographique de ses espiègles haikus.
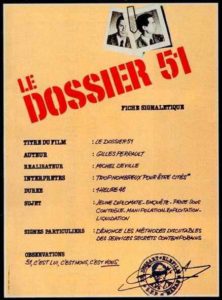 K comme Kafka
K comme Kafka
Si le cinéma de Michel Deville est d’abord tout sourire, il peut, on l’a dit, se montrer parfois chagrin. Et à cet égard il est un film qui catalyse toute l’angoisse du monde, celui d’un monde fliqué (aux relents complotistes, à ceci près que le cauchemar est avéré) où nous ne serions que des pions, c’est Dossier 51. Il n’est pas interdit à son endroit d’utiliser le terme kafkaien. On ne pourra à cet égard que se féliciter que l’écrivain tchèque porte le nom qui est le sien : la lettre K de cet abécédaire n’étant pas toujours facile à attribuer…
L comme Libertinage
Le sens du mot libertinage a doucement glissé. S’il qualifie aujourd’hui le comportement de ceux qui ne s’intéressent qu’aux plaisirs de la chair, ne rechignant pas à les conjuguer au pluriel, il a longtemps été la marque d’une vraie liberté d’esprit, faisant volontiers la nique aux superstitions religieuses. Mais les deux ont pu se confondre : intellectuel décalé, Sade a en son temps sans doute plus choqué par des idées que n’auraient pas dédaigné les anarchistes que par sa licence sur le plan des mœurs. Les personnages de Benjamin ou ceux de Raphaël sont sans doute de vrais libertins (de façon plus douloureuse, on l’a dit, pour ce qui concerne le second film). Mais sans revendiquer le droit systématique à des amours multiples et dégagés de toute morale chrétienne, ceux des premières comédies, tout comme ceux qui traverseront sur le tard nombre des films du cinéaste, du Mouton enragé au Fil à la patte, font montre d’une vraie liberté sur le plan sentimental…
M comme Musique
Certains cinéastes se méfient de la musique, faisant confiance à la capacité du scénario et au talent des comédiens pour susciter l’émotion. D’autres la préfèrent diégétique, ce qui implique qu’elle n’existe que lorsqu’un personnage allume la radio. Il arrive que Michel Deville, qui aime beaucoup les musiciens, les invite à exercer leur art en direct (Christophe Malavoy est professeur de guitare dans Péril en la demeure, Jean-Pierre Cassel joue du violoncelle dans L’Ours et la Poupée, etc.). Mais le plus souvent le cinéaste se range parmi ceux qui utilisent la musique comme élément constitutif de leur récit, soulignant une intention, rehaussant une émotion, contredisant parfois ce qui est verbalement exprimé. Il va jusqu’à demander à Michel Piccoli dans Le Paltoquet de la lancer par un simple claquement de doigt. Son champ d’action est le plus souvent la musique dite classique, en tout cas symphonique. Que serait Benjamin devenu sans le fraternel apport de Boccherini, de Mozart, de Haydn ?
N comme Nina Companeez
Nina Companeez est née dans un environnement favorable pour qui se destine à vivre pour le cinéma : son père n’est autre que Jacques Companeez, un scénariste ayant travaillé avec Renoir, Chenal, Siodmak, Clément, Becker… À peine sortie de l’adolescence, elle entame une carrière de monteuse. C’est avec cette casquette-là qu’elle commence à travailler avec Michel Deville, qui lui demande en parallèle d’écrire ou de cosigner ses scénarios. Ce qu’elle fera sans interruption jusqu’en 1971, quittant son alter ego sur un chef-d’œuvre, Raphaël ou le débauché. La fin de cette très fructueuse collaboration n’est pas le fruit d’une discorde, pas même d’un différend artistique, mais la mise en scène taraude depuis un moment la scénariste, qui signe alors (avec plus ou moins de bonheur) quatre films pour le grand écran (le premier, Faustine et le bel été, est le plus réussi) avant d’entamer une jolie carrière télévisée, marquée notamment par Les Dames de la côte, L’Allée du roi (qui a donné jadis vie à un numéro de L’Avant-Scène Télévision) et Voici venir l’orage, vaste fresque sur la Révolution russe qui s’inspire de l’histoire de sa famille…
O comme Ours
S’il fallait mettre une étiquette sur les films de Michel Deville, et accessoirement les réduire à un genre particulier, ce serait pour constater qu’ils sont beaucoup plus variés que ce que l’on aurait cru. Si Dossier 51 est un thriller, Péril en la demeure un film noir, Benjamin un marivaudage et Raphaël un drame de la passion, L’Ours et la Poupée peut facilement être assimilé à cette screwball comedy qui a fait les riches heures d’un certain cinéma hollywoodien, avec Cary Grant et Katharine Hepburn (par exemple) dans les rôles principaux. On ne sait si Jean-Pierre Cassel a l’aura du premier (c’était un grand admirateur du cinéma américain classique et il n’était pas maladroit en danseur de claquettes) ou si Katharine Hepburn aurait accepté de se dénuder comme l’a fait notre BB nationale, mais force est de reconnaître que le film n’aurait pas déparé dans l’œuvre de Hawks, de Leisen ou de Sturges (Preston, pas John). La question est bien sûr de savoir si pour autant tous les hommes des films de Deville sont des ours (mal léchés) quand leurs compagnes jouent à la poupée. C’est évidemment une bonne question, nous serons sans doute remerciés de l’avoir posée…
 P comme Perrault
P comme Perrault
Quand Michel Deville s’est séparé de Nina Companeez, son chemin a croisé celui de plusieurs scénaristes. Parmi lesquels un certain Gilles Perrault, dont les contes modernes (et réalistes) ont séduit le cinéaste. Ancien avocat, politiquement engagé (à gauche), grand spécialiste des fracas de la Seconde Guerre mondiale, passionné par le monde du renseignement, l’auteur du Pull-over rouge, de L’Orchestre rouge et de Notre ami le roi n’avait a priori que peu de points communs avec le cinéaste. Les deux hommes se sont pourtant entendus comme larrons en foire. Michel Deville a fait siennes les arcanes paranoïaques de ce Dossier 51 qui n’a hélas pas pris une ride (à l’heure du numérique, poser la question de notre incognito revient à entrer en dépression). Le sujet n’était pas nouveau pour Perrault (on se souvient du Serpent, de Verneuil, réalisé en 1973 cinq ans avant la collaboration avec Deville). Il l’était manifestement pour le signataire du Paltoquet. Qui n’a plus visité cette veine thématique par la suite. À l’exception sans doute et sous un jour totalement différent de son avant-dernier film, Un monde presque paisible, où le cinéaste renonce à toute légèreté pour s’intéresser à un groupe de juifs réapprenant à vivre au lendemain de la guerre. Mais Dossier 51 n’est pas pour autant l’unique collaboration Deville / Perrault, le tandem s’étant reconstitué quatre ans après leur coup de maître pour La Petite Bande, l’histoire très romanesque (cette fois-ci il s’agit bien d’un conte) d’un groupe d’enfants en fuite. Une particularité : si le film possède une bande-son de toute beauté, personne ne prononce le moindre mot. Une gageure et un signe d’auto-ironie, on en conviendra, de la part de deux hommes qui aiment tant jongler avec les mots.
Q comme Quart d’heure américain
Dans les booms de jadis, il était parfois de bon ton de laisser l’espace d’un quart d’heure les filles prendre l’initiative d’inviter les garçons à danser (alors que c’est l’inverse qui prévaut d’ordinaire). Par extension, la vague féministe ayant déferlé (avec plus ou moins de réussite), le terme a mis en lumière l’accession de la gent féminine à une certaine égalité de traitement. À cet égard il faut reconnaître que les femmes chez Deville ont dépassé dès son premier film le statut de faire-valoir pour souvent mener la danse. C’est la poupée qui se lance à l’assaut de l’ours, la fausse ingénue de Benjamin (Anne de Clécy) sait très bien comment mener sa barque, la voisine de Péril en la demeure (Anémone) ressemble à une araignée au milieu de sa toile, la femme aux tentations infidèles d’Eaux profondes est celle qui suscite le drame, etc.
R comme Rosalinde
Michel Deville fait la rencontre de Rosalinde Damamme pendant le tournage de L’Ours et la Poupée, en 1968, c’est sa famille qui habite la maison que le cinéaste a choisie pour être la demeure du personnage incarné par Cassel. Elle sera bientôt sa coscénariste, sa monteuse, sa productrice, son épouse, sa muse… Mais ne brûlons pas les étapes… Cinq ans après L’Ours et la Poupée, le cinéaste se lance dans le projet du Mouton enragé. Il demande à Rosalinde de le rejoindre. Avant de lui proposer de collaborer durablement et incidemment de partager sa vie. Rosalinde devient officiellement assistante (et parfois) costumière. Avant de prendre en mains la gestion d’Elefilm, la maison de production fondée par Michel dès Ce soir ou jamais. Rosalinde se mue en productrice. Épisodiquement elle apporte également sa part aux scénarios de son mari, comme c’est le cas pour La Lectrice, qui sans elle aurait sans doute pris moins de liberté avec le roman d’origine. Elle le révèle : « Michel avait écrit une première version du roman de Raymond Jean. Je lis et je trouve que ce n’est pas assez bien. Michel adore être extrêmement fidèle à ce qu’il lit et adapte. C’est comme un jeu d’arriver à tout mettre, mais au total, ça ne fait plaisir qu’à lui et à l’auteur. Ça m’amusait de retravailler le texte : changer les lectures, la psychologie des personnages, et la fin, que je trouvais horrible : “Je pars en claquant la porte, je vais être au chômage. Voilà, il n’y a plus de lectrice”. C’est devenu : “Je vais très bien, j’ai une voix merveilleuse”. Ça c’est moi, pas Michel, mon côté optimiste, béat, militant aussi. »
S comme Série noire
Il n’a sans doute jamais adhéré aveuglément aux lois du genre, mais Michel Deville a parfois rencontré la série noire. De Lucky Jo (d’après Pierre-Vial Lesou) à Toutes peines confondues (adapté du roman d’Andrew Coburn), en passant par Péril en la demeure (tiré du livre de René Belletto) et bien sûr Eaux profondes (pièce maîtresse de l’œuvre de Patricia Highsmith), notre homme s’est frotté aux passions souterraines, à la mort qui rôde plus souvent qu’à son tour. Même si c’était comme il le fait dans tous ses films pour sonder le cœur des femmes et des hommes qui y ont fait leur nid. Une curiosité : La Divine Poursuite est adapté de l’œuvre de Donald Westlake, un maître du genre, mais c’est peu dire que l’ambiance n’y est guère pesante, Deville ayant lancé ses personnages à la poursuite d’une statuette qui ne ressemble que de très loin au Faucon maltais de Hammett (et Huston).
T comme Tourbillon
La science du montage, la légèreté de certains personnages, qui confine parfois au frivole, font de plusieurs films de Michel Deville de véritables tourbillons cinématographiques qui nous entraînent dans une ronde endiablée. Benjamin, La Petite Bande, La Divine Poursuite, L’Ours et la Poupée, Un fil à la patte se donnent ainsi la main pour notre plus grand bonheur…
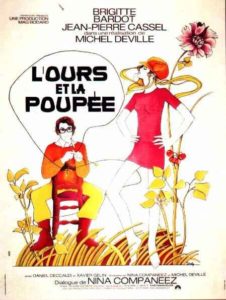 U comme Urbain / rural
U comme Urbain / rural
L’œuvre de Michel Deville n’a jamais fait l’impasse sur les lieux où étaient logées les passions de ses personnages. Le patrimoine bâti de ses films a de quoi rendre bien des agents immobiliers verts de jalousie. Le château de Benjamin, la villa douillette d’Eaux profondes, l’appartement de Nuit d’été en ville, le cabinet de La Maladie de Sachs, la maison de campagne de Voyage en douce, le café hall de gare du Paltoquet sont des lieux qui nous parlent. Souvent plus que ne le font les personnages eux-mêmes. Leur compilation conduit à constater que Michel Deville préfère manifestement la campagne à la ville. Ses maisons ont une âme surtout quand il installe directement son plateau chez lui (Le Voyage en douce). C’est L’Ours et la Poupée qui incarne à la perfection le fossé existant entre les constructions des campagnes et celles des villes (et par extension ceux qui les habitent, La Fontaine n’aurait pas dit autre chose). L’intérieur du très bel appartement de la poupée (avec une salle de bain d’anthologie, mais Michel Deville adore les salles de bains) est aussi différent du joyeux bazar rustique de la maison de l’ours que le sont leurs occupants. Ne doutons pas que le cinéaste connaît parfaitement les deux faces de la médaille… et qu’il sait parfaitement en jouer…
V comme Vidéo
S’il faut évidemment voir les films en salle, il n’est pas indifférent au cinéphile de pouvoir les revoir en vidéo (Truffaut était le premier à le reconnaître). À cet égard il faut dire que le travail effectué par Michel et Rosalinde Deville, avec la complicité de Gaumont, est absolument exemplaire. Soit quatre coffrets regroupant l’essentiel du cinéaste (manquent à l’appel quelques films mineurs). Avec des bonus de rêve, mitonnés avec gourmandise. Où Deville revient sur ses différents films, accompagné pour la circonstance de ses comédiens. Classique sans doute, mais cela n’a pas de prix. D’autant que certains de ceux qui ont été interrogés (Piccoli ou Nina Companeez entre autres) s’en sont allés depuis. Mais le charme ultime de ces DVD est de nous proposer des suppléments thématiques où le cinéaste s’est amusé à faire quelques compilations de ses obsessions récurrentes. Certaines centrales (il s’attarde sur les baisers ou sur la nudité), d’autres auxquels nous n’aurions pas pensé spontanément (les vaches)… L’édition date de plus de douze ans. Les DVDs ne se trouvent plus très facilement… Et s’ils étaient réédités ?
W comme Winkler
Michel Deville a porté à l’écran nombre de romans. La Maladie de Sachs en fait partie, mais c’est un roman mâtiné de journal intime, puisque son signataire Martin Winckler était effectivement médecin de campagne avant d’entamer une carrière plus médiatique. Le résultat : l’un des plus beaux films de Michel Deville, évidemment l’un des plus touchants et les plus empathiques. C’est une ode au genre humain qui nous est livrée. Et celui qui incarne le médecin, Albert Dupontel, qui bien souvent campe des personnages grinçants ou déchirés (parfois les deux à la fois comme c’est le cas dans ses propres films) est ici un modèle d’humanité.
X comme Xavier Gélin
Les films de Michel Deville sont indissociables de certaines figures du cinéma, de Mag Bodard à Michel Piccoli en passant par Jean-Louis Trintignant. Mais la filmo du cinéaste regorge de noms sans doute moins médiatisés qui ont pourtant constitué la chair même de son cinéma. Tel Xavier Gélin, fils de Daniel (et père de Hugo), tour à tour producteur et comédien. Il a ainsi coproduit La Lectrice en 1987, près de vingt ans après avoir été le majordome empoté de Brigitte Bardot dans L’Ours et la Poupée.
Y comme Yeux
Les yeux sont évidemment une fenêtre sur l’âme de celui qui les possède. Et la caméra de Michel Deville ne s’est pas privée de recueillir les regards des personnages de ses films. La voix peut se contrefaire, exprimer ce que l’on ne croit pas, les yeux ne savent pas mentir. Ainsi ceux de Michel Morgan au moment où ils versent une larme dans Benjamin, faisant écho avec deux ans d’avance à ceux de Françoise Fabian dans Raphaël…
Z comme Zone interdite
Quand il se laisse aller à quelque confidence, Michel Deville reconnaît avoir parmi tous ses films une tendresse particulière pour Le Paltoquet, un film on ne peut plus ambitieux quant à son écriture. Il n’entretient en revanche pas une relation des plus chaleureuses avec certains de ses films de commande, comme On a volé la Joconde ou Martin soldat. Mais il en est deux qui sont inscrits en zone interdite. Une balle dans le canon, réalisé au moment où Michel Deville débutait et qu’il lui fallait faire ses preuves. Un film coréalisé avec Charles Gérard, plus connu pour avoir été devant la caméra dans nombre des films de Claude Lelouch au tournant des années 1970. Deville admet aujourd’hui que les poursuites automobiles avaient été allongées afin d’augmenter la durée finale du film, faute d’inspiration. L’autre film précède immédiatement Benjamin… Tendres Requins (Zärtliche haie pour les puristes) est un improbable film de commande, produit majoritairement pas les Allemands. Il semble qu’aucune sortie française ait jamais eu lieu…
Yves Alion













