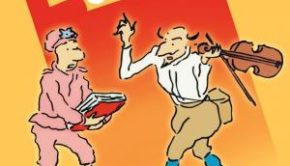Juste une nuit d’Ali Asgari
Ali Asgari, né en 1982, a réalisé ce deuxième long métrage à Téhéran, après Disappearance en 2017, dans des conditions qu’on suppose forcément artisanales et assez clandestines, vu la vigueur du propos. Mais après tout, l’errance à travers une grande ville pour trouver une issue impérative à un problème était le sujet d’un autre film tourné sans grands moyens techniques : Le Voleur de bicyclette, en 1948. Asgari n’est pas encore à la hauteur de De Sica, mais comme lui, il traite des limites imposées par la société à l’épanouissement des individus. Comme lui, il décrit un moment d’urgence. Comme lui, il associe au personnage principal, ici une jeune mère célibataire qui doit faire garder son bébé pour « juste une nuit », un personnage d’observateur et de soutien, ici la meilleure amie de la jeune femme. Dans un pays ordinaire, il suffirait que cette amie prenne une chambre d’hôtel avec le bébé et le tour serait joué. Mais en Iran une femme seule n’est pas acceptée dans un hôtel. Et chacun est contraint dans ses élans par les règles en vigueur depuis la Révolution islamique de 1979. Les deux actrices portent la tension du récit : Sadaf Asgari, la nièce du réalisateur, et Ghazal Shojaei ont une présence très forte. La traversée de Téhéran pour une aide presque impossible à trouver permet au cinéaste de décrire sa ville natale, qu’il avait quittée pour étudier en Italie. La puissance de description des films iraniens contemporains, alors qu’une Révolution nouvelle est en train de se produire, nous donne sans cesse de nouvelles leçons de cinéma. Nous essayons d’en témoigner dans un dossier du numéro de novembre de L’Avant-Scène Cinéma, publié alors que sortent presque en même temps Juste une nuit et Aucun ours, de Jafar Panahi.
René Marx
Ta farda. Film franco-iranien d’Ali Asgari (2021), avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei. 1h26.