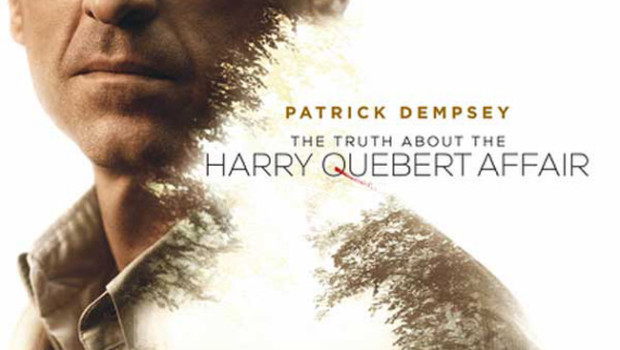Entretien – Jean-Jacques Annaud pour sa série télévisée et son autobiographie
Le Dernier Loup va bientôt fêter ses quatre ans et son prochain film pour le cinéma n’est encore qu’un projet, mais Jean-Jacques Annaud n’est pas pour autant dans un entre-deux immobile. Au contraire, il vient en l’espace de quelques mois de faire parler de lui à deux reprises, pour avoir réalisé une série et pour avoir signé un livre de mémoires.
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert est adaptée d’un roman à succès de Joël Dicker dont l’action se déroule en Nouvelle-Angleterre, et dont le personnage central est un écrivain en panne d’inspiration retiré dans la région, que l’on suspecte d’être le meurtrier d’une adolescente avec laquelle il avait quelques années plus tôt vécu une passion. La série développe plusieurs histoires parallèles. La première est celle de cet amour interdit dans une région où les idées nouvelles soufflent moins fort que l’air marin. Et Annaud nous régale d’un érotisme trouble qui rappelle les belles heures de L’Amant. La seconde tourne autour de la relation entre Quebert et un jeune auteur qui n’a pas son talent (mais vend bien), et qui l’a rejoint pour écrire un reportage romancé sur l’affaire, à la manière d’un Truman Capote. Mais coexistent des tas d’histoires secondaires qui forment un terreau fertile où poussent toutes les frustrations du monde. Ce qui permet que chacun passe à tour de rôle (de façon sans doute un peu systématique) sous les feux des projecteurs, apparaissant comme suspect. On attend bien le dernier épisode pour connaître la clé de l’énigme, mais au fond cela n’est pas fondamental. La série vaut d’abord pour son climat, pour la description d’une Amérique encore provinciale où les secrets de famille ne gagnent pas à s’étaler au grand jour. L’originalité n’est pas à l’égal de celle de La Guerre du feu ou de L’Ours, mais on sent bien que le cinéaste s’est régalé. Et nous avons tendance à l’imiter…
Les mémoires de notre homme ont en commun avec la série qu’elles sont épaisses, mais qu’elles se lisent d’une traite. Annaud a su trouver la bonne distance : entre l’anecdote et la leçon de cinéma, entre l’autoportrait narcissique et le détachement souverain. De fait, le livre est véritablement le fruit d’un imaginaire en perpétuelle ébullition, mais c’est aussi le récit d’une vie hors du commun, pour laquelle le cinéma est évidemment une raison principale d’avancer. Chaque chapitre est comme une odyssée détaillée avec gourmandise, une odyssée parfois bancale et douloureuse, à tel point qu’il semble miraculeux que tous les films que nous aimons aient fini par voir le jour. Les difficultés rencontrées pour faire charger les mammouths de La Guerre du feu ou traverser les bateaux sous le feu ennemi à Stalingrad auraient pu en décourager plus d’un. Annaud donne au contraire le sentiment que plus le sommet est haut plus il est enivrant d’en tenter l’escalade.
Vous avez adapté La Vérité sur l’affaire Harry Quebert sous la forme d’une série. Était-ce parce que l’histoire ne pouvait pas tenir dans un format cinéma, ou bien parce que vous vouliez absolument faire une série et que cette adaptation vous tendait les bras ?
Jean-Jacques Annaud : Je voulais faire une série. Depuis dix ans je vois bien qu’il y a une migration du talent et de l’énergie créatrice vers la télévision. Quand je suis à Los Angeles, je constate que c’est la panique dans les studios de cinéma. Et je peux vous dire que je reçois en continu des propositions de séries télé. La série a une clientèle, qui la réclame. Alors qu’au cinéma, il faut souvent pousser les spectateurs pour qu’ils aillent dans les salles. Les grands metteurs en scène américains, Martin Scorsese, Woody Allen ou Steven Soderbergh n’ont pas fait des séries par hasard, ils savent que c’est là que se trouve le public. Pour ce qui me concerne, j’avais aussi la curiosité de découvrir les méthodes de production de la série. Je ne veux pas rester dans le wagon de queue et arriver après tout le monde. Harry Quebert m’a permis de me fondre dans ces nouvelles normes, qui sont en vérité celles du feuilleton. Je suis un peu comme un écrivain habitué à livrer des romans de 250 pages et à qui l’on demande d’écrire un feuilleton de 1000 pages. La technique n’est pas la même. La façon de regarder les images non plus. Quand on m’a proposé le bouquin de Joël Dicker, il m’a paru flagrant que ce ne pourrait devenir qu’une série. Il y avait trop de personnages pour les faire tenir dans un film de deux heures. Les suspects ne le seraient jamais puisque l’on n’aurait pas le temps de leur donner un peu de chair. Pour autant je l’ai tourné comme d’habitude, comme si c’était un film, la différence est qu’il s’agit d’un film de près de 9 heures.
Un film sans doute plus facile à mettre sur pied, puisqu’il est essentiellement contemporain, que Le Nom de la rose ou La Guerre du feu…
J.-J. A. : Sans doute. Mais il n’a pas été si facile que cela à faire. De nombreuses scènes se déroulent plusieurs années plus tôt. Et c’est toujours compliqué d’aborder le passé, même s’il n’est pas très lointain. Il faut enlever les antennes de télé, ou parfois les ajouter, changer les voitures qui circulent, les costumes, etc. Au final cela coûte autant que si le film se passait au Moyen-âge.
Contrairement au cinéma, la série ne reste pas à disposition du spectateur très longtemps… Ce n’est pas frustrant de savoir que personne ne verra votre film sur grand écran ?
J.-J. A. : C’est un art éphémère. La gratification est immédiate, mais il est rare que l’on revoie les séries qui ont été diffusées. Quant au grand écran je vous dirai qu’il a changé de domicile. Autrefois pour couvrir son champ visuel, il fallait aller dans un cinéma et ne pas s’asseoir plus loin que la moitié de la salle. Aujourd’hui, si l’on possède un écran d’un mètre cinquante de diagonale dans son salon et que l’on s’installe à trois mètres, le champ visuel est aussi bien couvert. Je vais sans doute vous provoquer en ajoutant qu’il en est de même si l’on regarde un film sur son téléphone portable en le tenant à quelques centimètres. C’est le ratio qui importe. Le petit écran est par ailleurs plus maniable. Quand j’ai passé des mois en Mongolie pour repérer puis tourner Le Dernier Loup, il n’y avait pas la moindre salle à la ronde. Et puis même, les premières salles ne montraient que des films d’action chinois qui ne me passionnaient pas vraiment. Mais j’avais des DVDs. Il faut bien comprendre que le monde change. Et ceux qui ne le voient pas sont les mêmes qui ont ri en voyant arriver les premiers appareils photos numériques, en jurant qu’ils ne se passeraient jamais de pellicule. On a vu le résultat !
Néanmoins, les salles accueillent annuellement depuis plusieurs années plus de 200 millions de spectateurs…
J.-J. A. : Pour montrer quels films ? Je ne vais pas me plaindre : j’ai connu en tant que cinéaste bien des succès. Il n’empêche que je ne suis pas certain que la plupart des films que j’ai faits seraient encore possibles aujourd’hui. Aujourd’hui se pose vraiment la question de la survie des films intermédiaires, qui ne sont ni ces films faits avec des bouts de ficelle d’un côté, ni ces blockbusters intergalactiques chers à Hollywood de l’autre, qui ont le pouvoir de faire sombrer le studio qui les produit quand ils se plantent. Où sont les films à contenu ? Aujourd’hui beaucoup de spectateurs vont au cinéma pour rigoler ou pour se détendre, ou du moins avoir l’impression qu’ils se détendent. Pourquoi pas ? Mais il faudrait que les films un peu exigeants aient aussi leur place. J’ai eu la chance de voir Roma, de Cuarón, sur grand écran. C’est un film magnifique. Mais quelle galère pour y arriver ! Cuarón m’a raconté qu’aucun financier n’était prêt à se lancer dans l’aventure, alors qu’il a quand même signé un Harry Potter et Gravity ! Il réussit néanmoins à faire son film, il le montre à tous les distributeurs du monde : personne n’en veut. Et finalement c’est sur Netflix qu’il est visible ! Et puis il faut également ne pas perdre de vue que la télévision draine davantage de monde. Mes films ont été largement vus en salle, mais quand les gens m’en parlent c’est suite à un passage télé. Le Dernier Loup a peut-être attiré 20 millions de spectateurs chinois dans les salles lors de sa sortie. Mais il est passé il y a peu sur une chaine chinoise et ce sont entre 100 et 200 millions de spectateurs qui l’ont vu. Il est vrai que les chiffres sont toujours impressionnants en Chine.
Est-ce à dire que vous ne ferez plus que des séries ?
J.-J. A. : Non, évidemment. J’aime le cinéma profondément. Mais je suis peut-être dans la situation de l’acrobate que l’on vient débaucher au cirque pour lui proposer de faire du cabaret. Peut-être serais-je amener à faire du cirque ET du cabaret.
Revenons au cabaret… et à Harry Quebert… Quel est l’atout principal de la série ?
J.-J. A. : La série permet d’abord de donner un peu plus d’épaisseur aux personnages secondaires. Quand on a deux heures pour faire vivre dix personnages secondaires, mathématiquement on ne peut donner que six minutes à chacun si l’on garde l’une des deux heures pour les deux personnages principaux. C’est évidemment insuffisant. Avec Harry Quebert, j’ai pu consacrer 40 minutes à des personnages secondaires. Or j’adore les seconds rôles. D’abord parce que j’aime les acteurs qui les tiennent. J’étais admiratif de Jean Carmet, de Jean Bouise, etc. Avec cette série, je m’en suis donné à cœur joie. J’avais 238 rôles parlant à attribuer ! Même si la moitié n’a pas beaucoup plus à dire qu’une phrase unique…
La contrepartie était de tourner plus vite que vous ne le faites d’ordinaire…
J.-J. A. : Cela faisait partie du deal. Pour aller plus vite, je n’ai souvent fait qu’une seule prise après une répétition. J’aime assez ne pas multiplier les prises, sauf quand j’ai un acteur qui a besoin de se chauffer. Le problème est de mettre dans la même prise un acteur qui donne tout à la première prise avec un autre qui doit se chauffer pendant des heures. C’est ce qui m’est arrivé pour Sept ans au Tibet : Brad Pitt était bon à la quinzième prise, alors que David Thewlis démarrait à la première. Heureusement il était encore au point quand arrivait la quinzième… Je n’ai rien à redire. Certains acteurs ont besoin de temps pour s’incruster dans le rôle, Robert de Niro étant comme chacun sait le plus perfectionniste de tous. À l’inverse, sur Le Nom de la rose, Sean Connery était parfait à la première prise, excellent à la seconde, et puis à la troisième il oubliait son texte. Pourquoi ai-je voulu tourner vite ? Parce que les metteurs en scène habitués au 35 mm perpétuent les vieilles habitudes consistant à faire attention à ce qu’il n’y ait pas le moindre reflet dans la glace par exemple. À ceci près qu’aujourd’hui ces choses-là, on les vire après.
C’était moins souple avant…
J.-J. A. : Quand j’ai fait Coup de tête pour la Gaumont, Alain Poiré, que je respectais par ailleurs beaucoup, est venu me reprocher d’utiliser beaucoup de prises. Je lui ai répondu que j’étais habitué à la rigueur des films publicitaires et que je ne voulais rien laisser au hasard. Il m’a donné son feu vert. J’ai fait le film, Alain Poiré était content. Le montage le satisfaisait également. Mais il m’a quand même demandé s’il pouvait prendre mon assistante monteuse pendant deux jours pour voir quelles prises avaient été choisies dans le montage final. Résultat des courses : 60% des plans venaient de la première prise, 30% de la seconde et les 10% restants jusqu’à la prise 15. Je l’ai beaucoup remercié, car sans lui je n’aurais jamais pris conscience que je gardais les premières prises. C’est vrai que sur une première prise on a parfois un petit saut dans le traveling par exemple. Mais franchement si les acteurs sont convaincants, qui va venir râler parce qu’il y un petit saut dans le traveling du plan 527 ?
Est-ce à dire que la finition est devenue moins tenue ?
J.-J. A. : Vous me connaissez : j’ai relu dix fois la moindre ligne de dialogue et il n’est pas un seul des quelque mille plans que je n’ai pas contribué à étalonner… Mais à côté de cela, j’ai cherché à travailler à l’énergie, plus que dans le souci maniaque du moindre détail. Par ailleurs, je me suis rendu compte dès La Victoire en chantant que souvent les répétitions sont supérieures aux premières prises. Depuis l’arrivée du numérique, depuis que la pellicule n’est plus contingentée, puisqu’il n’y a plus de pellicule, je ne me prive plus de filmer les répétitions… Au final, celles-ci représentent peut-être un tiers du métrage de la série. C’est bien simple, il m’est arrivé une seule fois d’aller jusqu’à sept prises, et je me suis excusé ! J’ai en mémoire les conseils de Kurosawa à ses acteurs. Il leur disait : « Si vous tombez de cheval, courez derrière et tentez de remonter dessus, ou alors laissez-le partir et continuez à pied… ». Dans tous les cas il se passe quelque chose, tout vaut mieux que de baisser les bras et dire que l’on va recommencer. Dans la vie, il n’y a que des premières prises. D’une certaine manière ne conserver que des premières prises permet d’approcher des parfums de vérité. Quand on peaufine une scène jusqu’à l’outrance, on la fige… La technique n’est que secondaire.
Vous êtes pourtant un fou de technique. Vous avez fait de la 3D, de l’IMAX, vous êtes en recherche perpétuelle…
J.-J. A. : J’ai maîtrisé la technologie de bonne heure, cela me permet de ne plus y penser. Les trucages numériques actuels ne proposent rien de plus que ce que nous faisions à l’école de cinéma, avec le « cache contre-cache animé ». À ceci près que la sélection du cache et du contre-cache, au lieu de demander trois jours au laboratoire, plus le nettoyage de la tireuse, et un tirage par contacts avec les contre-griffes, se fait sur un ordinateur de débutant en deux secondes. Les défauts restent les mêmes. Quand je place un type sur un fond vert, que je lui demande de faire une déclaration d’amour à mon doigt sur lequel j’ai enfilé une balle de ping-pong, ce n’est pas la même chose que si je mets une fille à côté de lui sur une plage véritable. Je me souviens d’un diner à Londres avec Liam Neeson, qui sortait de Star Wars. Il m’a dit qu’il venait de passer la période la plus désolante de sa vie d’acteur. Ce n’est pas le cinéma que nous faisons. D’ailleurs les producteurs ne s’adressent pas non plus aux mêmes metteurs en scène. Personne n’a eu l’idée de demander à Bergman de faire un film de super-héros.
Les décors de la série étaient-ils tous préexistants ?
J.-J. A. : J’ai fait construire la maison sur la plage, à 800 km de Montréal. J’avais les couleurs de la Nouvelle-Angleterre, mais tout a été intégralement tourné au Canada. C’est la moitié du prix étatsunien. Parce que l’administration veille à accorder une vraie ristourne sur toute la finition, que le dollar canadien est plus bas que son homologue et qu’au final les techniciens sont payés moins cher… Après La Guerre du feu, Sept ans au Tibet et Les Ailes du courage, c’est la quatrième fois que je tourne là-bas, au moins partiellement, et j’en suis très satisfait. Les techniciens sont remarquables, ils se défoncent pour le film et ont le cœur sur la main… Mais parallèlement nous avons fait des repérages fous. Je crois avoir arpenté tous les chemins qui mènent à l’océan en Nouvelle-Angleterre, des deux côtés de la frontière.
On vous reconnaît bien là. Comme vous aviez visité toutes les églises et tous les monastères d’Europe pour établir votre propre guide Gault et Millau en vue du tournage du Nom de la rose !
J.-J. A. : Voyager, prendre des photos, faire des repérages, c’est aussi s’imprégner d’un état d’esprit, qui je l’espère se retrouvera ensuite à l’écran. Les Américains ne connaissent pas le Maine ou le Vermont, puisqu’ils ne les voient pas au cinéma, étant donné qu’il n’y a pas de techniciens disponibles dans ces régions-là… L’un des aspects du bouquin qui m’a conduit à y aller est justement dans le dépaysement. On voit très peu la Nouvelle-Angleterre au cinéma, alors que nous sommes abreuvés de Californie. J’ai été heureux de retrouver cette Amérique que j’avais connue dans les années 1970, qui est restée innocente et pleine de charme, aux antipodes de l’aigreur que portent les partisans de Trump.
Harry Quebert est d’abord une très belle histoire d’amour. Ce qui n’est pas le cas de nombre de vos films…
J.-J. A. : Effectivement, et cela m’a bien plu de renouer avec certains éléments qu’il y avait dans L’Amant. Je ne saurais pas dire comment fonctionnent aujourd’hui les jeux de séduction, mais je crois me souvenir que dans mes vertes années, les jeunes filles n’hésitaient pas à vouloir séduire des garçons plus âgés. Comme le film se déroule dans le temps, cela ne m’a pas gêné de mettre cela en scène.
Mais la relation entre Quebert et le jeune romancier qui s’intéresse à lui est tout aussi passionnante. On retrouve comme par hasard votre fascination pour la transmission, qui traverse tous vos films, à commencer par Le Nom de la rose et L’Ours…
J.-J. A. : Cela m’intéresse énormément. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et pour parvenir à quelque chose, je n’ai pas eu d’autre moyen que d’être bon en classe. C’est ainsi que j’ai vénéré mes instituteurs, mes professeurs, mes maîtres… J’ai le souvenir d’une phrase que je me répétais quand j’étais petit, qui m’invitait à me souvenir une fois que je serai grand que les petits sont des cons… Une façon de vénérer l’instruction, même si c’est un peu radical.
En lisant vos mémoires, on se prend à penser que vous avez mené une vie incroyablement romanesque, plus grande que nature. Vous avez fait des films qui étaient des projets fous, vous avez été sur tous les continents, vous avez croisé un nombre incalculable de gens, depuis les puissants de la planète jusqu’aux anonymes du bout du monde… On sent comme un appétit vorace de dépasser en permanence les frontières de la vie courante.
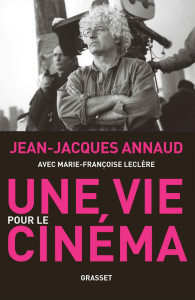 J.-J. A. : J’ai ce privilège de pouvoir rencontrer des gens dans le monde entier, et j’ai autant de plaisir à parler avec des gouvernants qu’avec mes voisins à la campagne, qui sont agriculteurs, où avec les paysans des plaines de Mongolie rencontrés pendant le tournage du Dernier Loup. Il faut dire que le cinéma est un langage universel, il rapproche. Je me souviens d’une virée en 4×4 avec Chen Zhen, l’auteur du bouquin dont le film est adapté. Nous étions un peu paumés au milieu d’un no man’s land quand nous avons aperçu une yourte surgie de nulle part. Un type à cheval est venu à notre rencontre. Chen Zhen est descendu de voiture pour expliquer ce que nous cherchions. Il est revenu vers moi pour me dire que le cavalier était intrigué par la façon dont j’avais fait les gros plans de Stalingrad ! En Mongolie, toutes les yourtes sont équipées de la télévision… Ça c’est un privilège. J’ai été invité à dormir sous sa yourte, qui sentait très fort les crottes de moutons. J’étais aux anges. Je lui ai dit que j’aimais les chants gutturaux mongols et il s’est mis à jouer sur un instrument typique.
J.-J. A. : J’ai ce privilège de pouvoir rencontrer des gens dans le monde entier, et j’ai autant de plaisir à parler avec des gouvernants qu’avec mes voisins à la campagne, qui sont agriculteurs, où avec les paysans des plaines de Mongolie rencontrés pendant le tournage du Dernier Loup. Il faut dire que le cinéma est un langage universel, il rapproche. Je me souviens d’une virée en 4×4 avec Chen Zhen, l’auteur du bouquin dont le film est adapté. Nous étions un peu paumés au milieu d’un no man’s land quand nous avons aperçu une yourte surgie de nulle part. Un type à cheval est venu à notre rencontre. Chen Zhen est descendu de voiture pour expliquer ce que nous cherchions. Il est revenu vers moi pour me dire que le cavalier était intrigué par la façon dont j’avais fait les gros plans de Stalingrad ! En Mongolie, toutes les yourtes sont équipées de la télévision… Ça c’est un privilège. J’ai été invité à dormir sous sa yourte, qui sentait très fort les crottes de moutons. J’étais aux anges. Je lui ai dit que j’aimais les chants gutturaux mongols et il s’est mis à jouer sur un instrument typique.
Vos films le dénotent : vous vous délectez d’embrasser le monde… On a l’impression que le cinéma n’est qu’un aspect de cela.
J.-J. A. : C’est un plaisir de vie inimaginable que de parcourir le monde. Mais le cinéma n’est pas un aspect parmi d’autres, il est au centre. Et toutes les expériences que je mène se retrouvent au final dans mes films.
Votre positionnement est atypique. Vous êtes sans doute le seul cinéaste français qui tourne à l’échelle du monde…
J.-J. A. : Le cinéma est pour moi un art universel. Un outil extraordinaire pour faire partager des idées. J’ai souffert quand j’étais jeune homme et que j’ai découvert le monde grâce aux films publicitaires qu’à Sydney ou à Hong Kong les films français n’étaient pas visibles en dehors de toutes petites salles en périphérie. J’avais envie si je faisais des films d’avoir l’exposition de Spielberg et que les gens voient mes films dans la grande salle. Ça me plaît de montrer mes films dans d’autres pays. Je me sens presque missionnaire en ce sens. Les films possédant une certaine surface commerciale sont systématiquement doublés, à la différence de ceux qui ont moins de potentiel et que l’on sous-titre. Mes films sont le plus souvent doublés. Les films sous-titrés colportent le plaisir de la langue d’origine, mais pas les idées puis qu’ils sont très peu vus. Comme chacun sait le cinéma est un art, mais aussi une industrie. Et je ne me désintéresse pas du second terme. Je suis français mais je n’ai passé que sept jours en France au cours des deux dernières années. Je ne peux pas faire autrement que de me sentir en communion avec tous les autres. Un jour j’étais en repérage à Uummannaq, sur une petite île au large du Groenland. Je me suis posé en hélicoptère sur une pointe rocheuse. Une femme est venue me demander si j’étais le réalisateur de Sept Ans au Tibet, qu’elle venait de montrer à ses enfants deux jours plus tôt. Et je me retrouve au bout du monde dans un froid polaire avec des enfants assis sur des cailloux qui me posent des questions sur le film. Ces enfants-là, je ne peux pas les oublier. C’est aussi pour eux que je fais des films.
Chacun de vos films est l’objet d’enjeux incroyables, que ce soit sur le plan financier, artistique, diplomatique… Chaque projet est une odyssée. Le pire est que cela semble redoubler votre plaisir…
J.-J. A. : Je pense que la prise de risque est essentielle. Le cinéaste fait un métier de création. Dès lors il a le devoir d’innover, de faire des prototypes. C’est en tout cas l’idée que je me fais du métier. Vous comprenez qu’il ne faut pas s’attendre à ce que je fasse un film de série, un polar dans les rues de Paris ou une comédie sentimentale en banlieue. Si je veux vraiment innover, il va de soi que je ne peux le faire qu’au bord du précipice. Si l’on ne prend pas le risque de sa casser la gueule, le jeu est faussé. J’aime Martin Scorsese, et j’aime ses films. Mais je n’aimerais pas une seconde prendre sa place pour raconter des histoires de mafieux dans les rues de New York. Il m’est arrivé jadis de rencontrer Hitchcock, qui avait vu La Victoire en chantant. Il m’a complimenté avant de me prendre à part pour me conseiller de ne pas faire comme lui, toujours le même film, parce que c’est très ennuyeux ! n
Propos recueillis par Yves Alion
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Coffret 4 DVD TF1 Vidéo.
Une vie pour le cinéma, de Jean-Jacques Annaud et Marie-Françoise Leclère. Grasset, 528 pages.