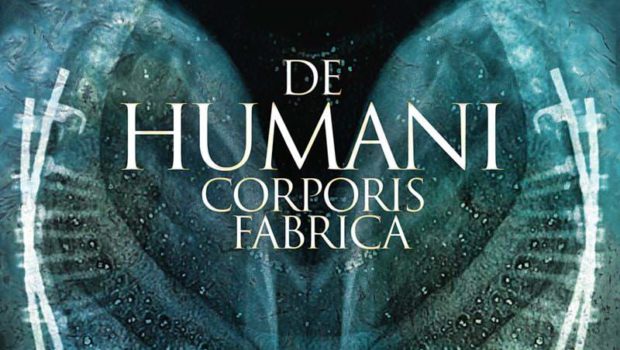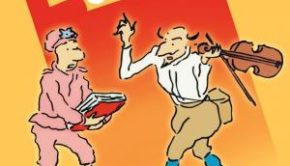De humani corporis fabrica de Verena Paravel et Louis Castaing-Taylor
Sensation du dernier Festival de Cannes, où il était présenté dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs – devenue entre-temps Quinzaine des Cinéastes – le nouveau long métrage de Verena Paravel et Louis Castaing-Taylor est un documentaire aussi éprouvant qu’exaltant dont il est difficile de sortir tout à fait indemne. Au-delà de ce qu’il montre, entre beauté abstraite d’un univers corporel inconnu et images insoutenables d’une chair en souffrance, il propose une réflexion passionnante sur ce qui fait corps.
Le dernier territoire inconnu était donc notre corps. Ou plus exactement, l’intériorité secrète de ce corps, savamment dissimulée derrière la membrane opaque de son enveloppe dermique – et des siècles d’un tabou persistant. C’est ce que l’on réalise en découvrant le nouveau documentaire immersif et radical du duo Verena Paravel et Louis Castaing-Taylor (auquel on devait déjà, entre autres, l’hypnotique Léviathan et le puissant Caniba) qui nous embarque dans plusieurs salles d’opérations hospitalières dont il entreprend de nous montrer les coulisses. C’est-à-dire, non pas ces scènes vues à la pelle dans les séries consacrées aux services d’urgences ou de chirurgie, mais celles qui se déroulent simultanément autour et à l’intérieur du patient anesthésié. Le film est d’ailleurs né de cette idée : puisque “la médecine moderne s’est approprié les outils du cinéma pour sa propre pratique”, pourquoi le cinéma ne s’emparerait-il pas à son tour des technologies développées pour le corps médical ? On parle, ici, de cette imagerie produite par des instruments robotisés capables de filmer dans notre organisme, et qui constitue une part importante de De humani corporis fabrica (le titre lui-même renvoie à l’ouvrage publié par l’anatomiste André Vésale au XVIe siècle, qui fut le premier à dévoiler le corps à la science).
En parallèle, les deux cinéastes ont filmé les soignants au travail avec une caméra miniature fabriquée spécialement pour eux, et ont également utilisé les images des caméras scialytiques installées au-dessus des tables d’opération et utilisées pour archiver tout ce qui s’y passe. Ce mélange dans les registres d’images permet d’alterner les séquences intérieures, indéchiffrables, mystérieuses et souvent abstraites, et les gestes médicaux filmés de très près, qui perdent eux aussi toute signification concrète pour le spectateur profane. Tout ce que l’on sait, tiraillé entre ces deux formes de plans, c’est la vulnérabilité bouleversante du corps humain, et l’énergie, la force, et même la puissance mises à son service afin de lui permettre de continuer à fonctionner.
Le plus saisissant étant que celles et ceux qui manient le scalpel avec une telle dextérité, prouvant à chaque geste le chemin accompli par l’espèce humaine, ont en eux la même fragilité que leurs patients, kilomètres de boyaux, de tissus et de chairs peut-être sur le point de flancher à leur tour. Cette ambivalence immense (ce qui s’apparente à de la toute-puissance d’un côté : l’homme devenu l’égal d’un Dieu ; et ce qui constitue une faiblesse vitale de l’autre : l’homme créature identique à toutes les autres, renvoyée à sa corporalité, et soumise à la moindre blessure, au plus petit dérèglement organique) réaffirme la place de l’être humain dans un grand tout dont il n’est qu’un rouage – et encore, un de ceux dont il est aisé de se passer.
On se dit, à la vue de cette incroyable plongée dans notre propre corps, qu’un petit miracle est à l’œuvre chaque fois que tout fonctionne correctement, et que c’est peut-être – finalement – l’état de parfaite santé qui est exceptionnel. La médecine, via ses gestes réparateurs, apparaît alors dans toute sa prodigieuse splendeur. Il y a ainsi quelque chose de l’ordre de l’exaltation devant ce qui pourrait pourtant sembler comme une profanation insupportable, ou répugnante. Il faut avoir le cœur bien accroché, il est vrai, pour supporter – sans détourner le regard – la césarienne en gros plan ou les incisions de l’œil. Et que dire de ce moment suspendu où le chirurgien utilise marteau et burin pour casser quelque chose (des cartilages ? des os ?) à l’intérieur d’un patient, avant de revisser tranquillement les différents éléments… “Que Dieu me préserve des mains des chirurgiens” s’amuse un chirurgien, et à cet instant précis, il résume parfaitement la pensée du spectateur, aussi admiratif soit-il des prouesses de la science.
L’autre force du film est justement de nous livrer, sans fard, les propos tenus dans les blocs opératoires, et qui tranchent souvent avec la solennité apparente du moment, qu’il s’agisse d’une conversation terriblement banale sur le prix de l’immobilier à Clichy ou d’une dispute entre soignants. Cela pourrait sembler anecdotique, et pourtant ce décalage entre le geste et la parole est l’une des clefs pour appréhender ce qui se joue derrière les murs de l’hôpital, à savoir le rapport étroit qu’entretient chaque membre du corps médical avec la maladie et la mort qu’il côtoie quotidiennement. Lorsque l’on palpe ou découpe l’intimité la plus intérieure de ses semblables à longueur de journée, il est indispensable d’avoir le recul nécessaire pour se détacher de ces intrusions permanentes, de la souffrance et de la peur auxquelles elles sont liées, pour s’en extraire, et continuer à exercer avec le moins d’affect possible.
Prenant de la hauteur par rapport aux nouveaux paysages intérieurs qu’il dévoile, et que le spectateur n’oubliera vraisemblablement pas de sitôt, De humani corporis fabrica s’intéresse en effet à un autre corps, celui, social, de l’hôpital, qui ressemble étonnamment au nôtre avec ses différents organes, ses boyaux (il y a dans le film de touchantes séquences filmées dans les couloirs, comme celles qui mettent en scène un duo de vieilles dames dont l’une ne cesse de répéter en boucle les phrases que lui disent vraisemblablement les infirmières jour après jour), ses dysfonctionnements et ses maladies mortelles. Et qui lui-même fait partie d’une entité plus globale qui est la société. C’est le moment où Verena Pavel et Louis Castaing-Taylor réinjectent discrètement du politique dans ce qui était à la fois poétique (certaines images sont véritablement de toute beauté – au-delà de ce qu’elles représentent concrètement) et vertigineusement métaphysique (notamment la dualité entre notre finitude face à la mort, et les perspectives infinies que les images médicales ouvrent sur notre intériorité). On pense évidemment au sort incertain de l’hôpital public menacé par les intérêts financiers de quelques-uns, au personnel médical pressuré et soumis à des cadences de plus en plus inhumaines, aux patients en attente de lit et qui meurent parfois au beau milieu d’un couloir. Ce corps-là est à notre image : merveilleux de technicité, et menacé de l’intérieur comme de l’extérieur.
A bien des égards, De humani corporis fabrica change le regard du spectateur : sur lui-même, bien sûr, sur ses semblables, c’est évident, mais aussi sur le monde dans lequel il vit et dont il perçoit que le principe d’interconnexion générale qui le fonde est à la fois sa plus grande force et son irrémédiable faiblesse : aucun organe n’est susceptible de survivre à la disparition de tous les autres.
Marie-Pauline Mollaret
Film documentaire franco-suisse de Verena Paravel et Louis Castaing-Taylor (2022), 1h58.