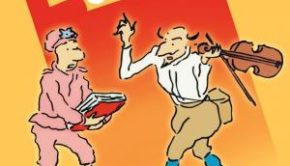Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
Le surgissement de Céline Sciamma dans le cinéma français n’est désormais plus une nouveauté, et la maturité a toujours été un passage difficile pour les récents prodiges du cinéma français. La réalisatrice ne se facilite de fait pas vraiment la tâche en cédant aux sirènes d’une sorte de cliché obligé de ce passage, le drame en costumes… Le thème même de son récit, la description d’une passion interdite entre deux jeunes femmes, participe à la codification actuelle du genre, qui joue souvent avec la manière dont les auteurs arrivent à infiltrer, dans des époques passées, des tabous (dans ces années-là) guère mentionnés par les œuvres alors produites. Naturellement, Sciamma est bien plus maline que cela, mais le jeu se situe précisément ici : comment faire bouger les lignes, comment éviter les pièges (visuels, narratifs) imposés par le lourd carcan du film d’époque ? Comment infiltrer la respectabilité si prononcée des drames costumés en se respectant soi-même ? D’où l’intérêt pas si vain que cela de ce fameux passage obligé. Il y a effectivement, dans cette confrontation avec des problématiques telles que la reconstitution, des questions qui peuvent ensevelir certains cinéastes ou leur permettre une inventivité, voire une réinvention, salvatrice. Au tour de la réalisatrice de Bande de filles de tenter le pari donc…
Un des premiers éléments de réponse sur l’approche adoptée par l’auteure est pictural. Profondément et purement pictural. En effet, comme son nom l’indique, Portrait de la jeune fille en feu est l’histoire d’une image, d’une peinture bien évidemment. De fait, le récit entier se place dans cette perspective puisque c’est une deuxième peinture, et deuxième image, qui le clôt. La première, le portrait, pose les questions, romanesques ou personnelles, qui seront traitées dans l’histoire. La seconde image les clôt littéralement, en apportant plusieurs réponses centrales qui éclairent et donnent sens aux événements décrits. En faisant de deux peintures le point névralgique de son scénario, Sciamma met intelligemment la représentation au cœur du long métrage, permettant une salvatrice distance avec le réel cru, souvent piège de bien des films à costumes. Soit une jeune peintre, invitée sur une île désolée afin de livrer le portrait d’une mystérieuse jeune femme de fort bonne famille, portrait fréquemment compromis par le comportement imprévisible de son sujet. La fascination pour le modèle devient une question esthétique essentielle : comment retranscrire la beauté, la passion, le regard portés sur un être qui vous obsède ? Une problématique qui double, recouvre, celle de la retranscription historique, en occupant son créneau, celui de l’impossible reproduction (d’une époque, d’un visage, d’une histoire). Et, en confiant le rôle de la jeune femme à sa muse avérée, Adèle Haenel, Sciamma se lie de toute évidence à l’héroïne de son film, sa fascination pour les traits et le charisme de l’actrice épousant parfaitement celle de la cinéaste. Comme dans tout grand film, la limite fond et forme disparaît totalement, l’un se perdant dans l’autre.
Reste quand-même la question et le défi : comment se sortir du piège du passé ? Le drame à costumes, avec ses clichés et son hypocrisie sur la représentation faussée d’un passé souvent déguisé en présent bis, pour ne pas choquer le public, demeure un test de vision, d’autant plus tranchant que le dernier long métrage de l’auteure se distinguait par son impression crue de réel à vif. Sciamma ne tente pas de recréer cette impression dans un cadre historique. Elle procède plutôt par une forme d’élimination. Le monde (les amies, la banlieue, la société), qui s’imposait tant à Bande de filles est ici presque entièrement évacué. La réalisatrice se sert de l’île, centrale au décor, pour poser une isolation qui va devenir le cœur du film, en finissant par créer un mini univers autour des deux héroïnes, une utopie personnelle. La reconstitution devient ainsi encore plus caduque. Il n’y a pas d’époque à recréer, puisque le temps dépeint n’appartient à nulle époque, et ne semble surgir que des sentiments de ses deux protagonistes. De quoi parle-t-on alors vraiment dans Portrait de la jeune fille en feu ? D’art, d’amour, de tout cela marié à une fascination mutuelle ? De regrets et de passions inassouvies ? Ou peut-être simplement de la création, création d’une image en particulier ? De ce fameux portrait, essence d’un instant capturant l’obsession de l’artiste pour le modèle, ainsi que les passions dévorantes qui les brûlaient à cet instant ? Peut-on simplement figer ce genre de moments ? C’est ce que l’héroïne tente et, à travers elle, la cinéaste, bien entendu.
Quant à l’histoire d’amour en elle-même, l’alchimie et le parcours des deux jeunes femmes, elle s’inscrit pleinement dans une sorte de sous registre, du moins lors de sa première partie, communément associé au film en costumes, celui d’une sensualité étouffée, qui ne peut s’exprimer que dans des creux ou des non-dits, faute d’encourir les foudres de la société. Une matière hautement cinématographique (filmer les tremblements, les émois non exprimés, une forme d’indicible) que plusieurs grands cinéastes ont su élever vers du grand art. Sciamma est plutôt à l’aise, et même virtuose dans ce registre, mais n’y fait pas spécialement preuve du souffle ou de l’originalité qu’elle possède la plupart du temps. Mais subitement, lorsque les personnages se retrouvent seuls, que leur île devient un royaume et que les élans peuvent s’exprimer, un autre élément traverse la caméra de Sciamma. Celui de l’utopie, du vase clos, coupé du monde, des hommes et des regards, ou leurs vies, leurs désirs, pourraient s’exprimer pleinement. C’est bien là que la réalisation de Sciamma semble trouver tout son sens. Il s’agit bien de dépeindre un modèle, qui n’est en fait pas seulement l’objet du désir, mais quelque chose de plus profond et abstrait. L’essence du cinéma et de la nostalgie, ce fameux paradis perdu, n’ayant peut-être jamais existé, qui valide totalement la structure en flash-back. Nous sommes bien dans le souvenir, une forme de récréation mentale, artistique et subjective, d’un moment, un amour et un monde bien engloutis. Au cinéma de faire vivre et figer, en un geste qui lui est si spécifique, ce sentiment passé. Finalement tout se finit par un autre portrait. C’est la dimension trompeuse du titre du long métrage : il n’y a pas un mais deux portraits de la jeune femme. Le second est d’apparence beaucoup plus classique, sans le feu décrit et contenu dans le premier. Mais sa sagesse dénuée de passion n’est qu’apparente. Entre les mains de la femme peinte se trouve un indice rappelant la férocité des sentiments l’ayant alors consumée. Un pertinent résumé de l’œuvre, dans ce feu sous la glace ici codé et caché aux regards des autres. Mais aussi un pari plus large : imaginer que les images, les portraits, soient les récipiendaires de nos amours mortes, de nos vies passées. Toute l’ambition, non négligeable, de ce Portrait de la jeune fille en feu est là. Son optimisme aussi, sa croyance en une utopie, même passagère, ainsi qu’en des tableaux capables de capter, conserver à jamais, l’intensité des sentiments.
Pierre-Simon Gutman
Film français de Céline Sciamma (2019), avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luana Bajrami. 2h.