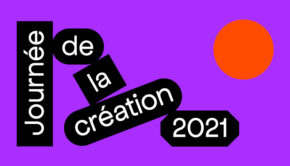Berlinale 2018 : une 68e édition féminine et engagée
Fidèle à sa réputation de festival sérieux, engagé et féministe, la Berlinale 2018 a fait la part belle à la fois aux personnages féminins et aux films véhiculant un fort message politique. La réalité y était également très présente, que ce soit sous la forme de faits réels ou de personnages existants. Comme toujours foisonnantes et éclectiques, les différentes sélections nous ont ainsi offert de belles découvertes et des confirmations, d’inévitables déceptions, et surtout quelques coups de cœur incandescents.
Le 68e Festival de Berlin, qui s’est tenu du 15 au 25 février dernier, s’est achevé sur l’inattendu couronnement de deux réalisatrices, Adina Pintilie et Malgorzata Szumowska, respectivement Ours d’Or pour Touch me not et Grand Prix pour Twarz (Mug). Le premier est un essai intime, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, dans lequel des acteurs parlent avec franchise de leur sexualité, le second met en scène un ouvrier polonais gravement défiguré suite à un accident et qui subit une reconstruction faciale le transformant en quelqu’un d’autre.
Adina Pintilie, cinéaste roumaine dont c’est le premier long métrage, s’offre d’ailleurs un doublé puisqu’elle remporte également le prix du meilleur premier film toutes sections confondues. Deux autres réalisatrices reçoivent les plus hautes distinctions dans leur catégorie : Ines Moldavsky, Ours d’or du court métrage pour The Men Behind the Wall et Ruth Beckermann, Prix du meilleur documentaire pour Waldheims Walzer.
Signe des temps ou coïncidence ? Berlin est, depuis longtemps, un festival qui fait la part belle aux femmes, qu’il s’agisse des réalisatrices (4 Ours d’or en 12 ans, tout de même, dont deux d’affilé) ou des films eux-mêmes. Cette année ne fait pas exception avec une compétition qui débordait de très beaux portraits de femmes, des héroïnes de Touch me not à celle de Las Herederas de Marcelo Martinessi, une femme d’âge mûre recouvrant sa liberté après l’emprisonnement de sa compagne (il a valu un prix d’interprétation à sa comédienne principale, Ana Brun), en passant par une Romy Schneider intime et sur le fil dans Trois Jours à Quiberon d’Emily Atef , ou l’étudiante dure à cuire qui s’oppose au pouvoir en place dans L’Île aux chiens de Wes Anderson.
Festival politique
La Berlinale s’est également avérée fidèle à sa réputation de festival politique, qui privilégie les œuvres engagées. Hors compétition, on a ainsi découvert le documentaire Eldorado, de Markus Imhoof qui va à la rencontre des réfugiés, à la fois lors de missions de sauvetage en mer et dans les camps établis en Italie. Il observe leurs conditions d’accueil et dresse un parallèle, pas toujours très habile, mais qui lui tient à cœur, avec la petite fille italienne que sa famille avait recueillie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans un autre genre, deux films en compétition évoquaient des événements historiques passés pour mieux dénoncer la situation actuelle. Dans Season of the devil, Lav Diaz propose ainsi un parallèle transparent entre les exactions commises aux Philippines sous la dictature de Ferdinand Marcos et celles permises par Rodriguo Dutertre dans sa grande campagne anti-drogue et criminalité. Il le fait bien sûr à sa manière, dans un interminable film de 4h conçu comme une tragédie certes musicale mais surtout statique et sans espoir.
Alexey German Jr, lui, raconte cinq journées dans la vie de Sergueï Dovlatov, futur grand écrivain russe de la fin du XXe siècle. On est à la fin des années 1970, sous la dictature de Brejnev, et la censure et la bêtise empêchent le jeune homme de publier le moindre texte. Le réalisateur filme un pays au point mort, enlisé dans son propre passé, et niant systématiquement tout avenir à ses forces vives.
Réalité et cinéma de genre
Le réel était par ailleurs particulièrement à l’honneur, avec des films mettant en scène des personnages ayant existé (Romy Schneider et Sergueï Dovlatov, mais aussi le cartooniste John Callahan dans T’inquiète pas, il n’ira pas loin à pied, de Gus van Sant ) ou des événements étant réellement survenus comme la prise d’otages d’un avion en provenance d’Israël par un commando du Front populaire de libération de la Palestine et du mouvement allemand Revolutionäre Zellen (Otages à Entebbe , de José Padilha), ou l’assaut par un militant d’extrême droite du camp des jeunes travaillistes norvégiens sur l’île d’Utoya le 22 juillet 2011 (Utoya 22. Juli, d’Erik Poppe).
Enfin, on a eu l’impression d’une forte proportion de films de genre. Pig, de Mani Haghighi oscille par exemple entre la farce et la série B pour parler de l’Iran d’aujourd’hui, entre censure, interdiction de tourner et tyrannie des réseaux sociaux tandis que Transit, de Christian Petzold a recours à l’uchronie pour dresser un parallèle entre les juifs fuyant l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et les réfugiés d’aujourd’hui. Kim Ki-Duk, lui, reprend dans Human, Space, Time and Human le motif du film de survie (sanglant) en enfermant ses personnages dans un bateau dont ils ne peuvent pas s’échapper, le tout pour une démonstration (au marteau-piqueur) de la cruauté et de la violence de l’être humain.
Mais si le niveau a semblé comme à son habitude plutôt inégal (Cannes, en embuscade, empêche beaucoup de bons films de venir à Berlin), cela ne nous a pas empêchés de découvrir quelques pépites qui valaient bien le déplacement. Petit tour d’horizon, à chaud, de nos coups de cœur toutes sections confondues pages suivantes :
Dovlatov
Sergueï Dovlatov, futur grand écrivain russe de la fin du XXe siècle, est dans une impasse professionnelle. Aucun média officiel n’accepte en effet de publier ses textes, et il en est réduit à couvrir des événements patriotiques pour des journaux serviles obsédés par le fait d’être « positif » et donc conforme à la ligne du parti de l’époque.
Alexey German Jr nous plonge dans la communauté artistique du Leningrad de la fin des années 1970, bouillonnante d’une vitalité fougueuse et vibrante qui tranche avec l’immobilisme frileux dans lequel se trouve le pays. Le cinéaste filme brillamment les portraits de groupe, captant avec sa caméra aérienne la chorégraphie des corps et des esprits tandis que l’intelligence des personnages transparaît dans des dialogues percutants et enlevés qui dissimulent mal leur irrémédiable désespoir.
Magnifiquement incarné par le comédien Milan Maric, Dovlatov est un trublion cynique et désabusé qui refuse pourtant toute forme de compromission. Esprit brillant persécuté par les médiocres et les faibles, il est l’archétype de celui qui a raison contre tout le monde, et continue à croire en son destin coûte que coûte. On a beau être dans l’URSS de Brejnev, les thèmes abordés (droiture morale, nécessité de créer, impossibilité viscérale de renoncer à qui l’on est) trouvent facilement un écho dans notre époque. Une œuvre dense, atemporelle et universelle, qui fait aussi l’éloge de l’art comme arme ultime contre la bêtise, la tyrannie et l’horreur.
Film russe d’Alexey Guerman Jr. (2017), avec Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka. 2h06. (Compétition)
Grass
C’est peut-être le film le plus brillant vu à Berlin cette année : une énième variation de Hong Sang-Soo autour du couple et des relations humaines, filmée en lieux clos dans un café et un restaurant où les personnages se croisent, se font écho et se rencontrent. L’argument, comme toujours chez le réalisateur coréen, est confondant de simplicité : plusieurs « duos » (un homme, une femme), se succèdent à une table de café, et parlent de leur vie actuelle et du passé, ou d’un tiers, qui les relie. Un peu à part, une jeune femme les observe, les écoute, et propose en voix-off ses propres commentaires à la conversation en cours. Elle est assise derrière un ordinateur qui laisse planer le doute : est-elle une écrivaine qui s’inspire de la vie des gens, ou carrément la scénariste de ces différentes rencontres ? Le film laisse planer le doute, et peu importe, au fond, tant il est transparent qu’elle représente à la fois la figure du réalisateur, qui ordonne ce qui se passe à l’écran, et celle du spectateur, qui n’en perd pas une miette.

Hong Sang-soo fait ici la démonstration de la précision de son écriture. Chaque scène est précisément écrite, jouant sur toute la palette des émotions humaines, et tissant avec le reste du film des correspondances nombreuses qui révèlent peu à peu le fil directeur de ce récit à tiroirs. Le résultat final est un ensemble ultra cohérent, léger et bienveillant, où rien n’est dû au hasard, et dont il se dégage une chaleur humaine inhabituelle chez Hong Sang-soo. Même la mise en scène habituellement minimaliste du cinéaste nous offre quelques moments de grâce, comme cette séquence finale si finement chorégraphiée que la géographie des lieux et les mouvements des corps suffisent à nous éclairer sur les rapports de chacun avec les autres. De l’intérieur à l’extérieur, d’un plan serré à un plan d’ensemble, les liens se renouent, les émotions se libèrent, les espoirs renaissent.
Film coréen de Hong Sang-soo (2018), avec Kim Min-hee, Kee Joobong. 1h06 (section Forum)
The Green Fog
Guy Maddin et ses complices Evan et Galen Johnson proposent un remake de Sueurs froides réalisé uniquement à partie d’extraits de films et de séries se passant à San Francisco. Il s’agit à l’origine d’une « commande » du San Francisco International Film Festival à l’occasion de son soixantième anniversaire, commande que s’est parfaitement appropriée le trio, transformant l’exercice en récit halluciné rendant autant hommage au film d’Alfred Hitchcock et à la ville de San Francisco qu’au cinéma lui-même.
Pour le spectateur, le jeu est bien entendu de reconnaître les extraits (plus d’une centaine d’œuvres ont été utilisées) tout en tentant de reconstituer l’intrigue de Sueurs froides à partir de ces éléments disparates organisés en vastes chapitres qui semblent plus thématiques que chronologiques. Le trio de cinéastes s’amuse ainsi à jouer au jeu des associations d’idées, juxtaposant des séquences qui se répètent ou se font écho, comme ces poursuites sur des toits, ces mains qui s’étreignent, ou ces différentes apparitions d’un improbable Chuck Norris à l’air triste. La musique suffit à unir ce flot d’images en une seule narration, donnant un nouveau sens à chaque plan, et permettant au spectateur de s’inventer son propre récit.
Le film joue aussi de la fascination qu’exercent sur nous, pauvres spectateurs-voyeurs, les visages sur grand écran. Les plans sur ces visages sont une des figures récurrentes du film, qui finissent par avoir un effet purement hypnotique. Les cinéastes ont en effet eu l’idée de supprimer la plupart des dialogues, et donc de ne garder que les plans entre deux répliques. Cela donne une longue succession de mimiques et d’expressions totalement vidées de leur sens initial, provoquant tantôt le rire, tantôt un certain effroi, et conservant surtout leur part de mystère. Comme un regard introspectif sur les émotions les plus primitives que fait naître en nous le cinéma.
Film américain de Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson (2017). 1h03. (section Forum)
L’Île aux chiens
Berlin avait donc invité le nouveau film de Wes Anderson non seulement à concourir pour l’Ours d’or, mais également à faire l’ouverture de cette 68e édition. Bien lui en a pris puisque le film a séduit le jury, le public et la presse, et est reparti avec un prix de mise en scène mérité, saluant autant la virtuosité et la cohérence de l’animation que la construction cinématographique du récit.
Principalement réalisé avec des marionnettes animées en stop motion, L’Île aux chiens se déroule au Japon, dans un futur proche. Profitant d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la déportation de tous les chiens, qu’ils soient errants ou domestiques, sur une île voisine servant de décharge publique. Alors que tout espoir semble perdu pour les malheureux animaux, qui sont condamnés à s’entretuer pour survivre, l’arrivée d’Atari, un jeune garçon en quête de son chien Spots, change radicalement la donne.
Une intrigue simple mais efficace qui permet à Wes Anderson de signer un formidable film d’aventures dont les héros sont véritablement les chiens, et qui mêle l’humour propre au cinéaste à un regard plus politique sur les questions de ségrégation, de maltraitance des animaux et de manipulations politiques. Si l’on peut parfois être perdu par la profusion de détails et de sous intrigues que propose le film (et notamment la multiplication des flashs-back qui induit une brillante mais complexe déconstruction du récit), impossible de bouder son plaisir devant ce récit initiatique canin à la fois très sérieux (au niveau des enjeux) et totalement déjanté (au niveau formel).
Isle of Dogs. Film américain de Wes Anderson (2017). 1h41. (compétition)
The Real Estate
Une sexagénaire trop gâtée hérite d’un important bien immobilier qui appartenait à son père, mais s’aperçoit rapidement que le cadeau est empoisonné : l’immeuble est mal tenu, de nombreux locataires sont là illégalement, et son neveu détourne une partie des loyers. Elle décide alors contre toute attente de partir dans une sorte de croisade punitive.
Véritable ovni de la compétition, The Real Estate transcende une intrigue peu engageante avec des effets de mise en scène hallucinés (gros plans sur le visage de l’héroïne, teintes blafardes, cadres qui rendent tout irréel…) et une musique à l’unisson qui insuffle sa propre tonalité au récit. On a l’impression d’être dans un cauchemar éveillé qui oscille entre de captivantes fulgurances visuelles et des séquences de moins en moins lisibles.
Même s’il n’est pas complètement abouti, et qu’il a de quoi agacer les spectateurs les plus allergiques au cinéma expérimental, c’est très clairement l’un des films les plus inventifs et les plus singuliers de cette édition berlinoise. Mention très spéciale à la comédienne principale, l’incroyable Léonore Ekstrand, qui porte avec un beau mélange de fantaisie et de premier degré cette héroïne totalement punk qui s’ignore.
Toppen av ingenting. Film suédois d’Axel Petersén et Mans Mansson (2018), avec Léonore Ekstrand, Christer Levin, Christian Saldert. 1h28. (compétition)
Unsane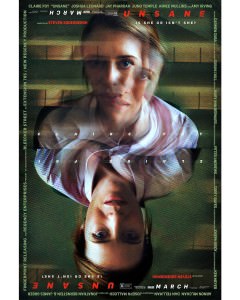
Entièrement réalisé avec un iPhone, Unsane est un thriller tendu et efficace dont l’intrigue colle parfaitement avec l’air du temps. Sawyer Valentini (interprétée avec conviction par Claire Foy, la révélation de la série The Crown) a dû fuir sa ville et ses amis après avoir été harcelée par un homme qui s’était épris d’elle. Toujours traumatisée, la jeune femme se rend dans une clinique privée pour une consultation psychologique, et se retrouve internée contre son gré. Là, son pire cauchemar la rattrape.
L’histoire est certes classique, mais le film qu’en tire Steven Soderbergh ne manque pas de panache. Sa mise en scène découpée et précise offre une grande fluidité au récit qui ne laisse jamais à l’héroïne, ni au spectateur, le temps de souffler. On a le sentiment d’une machine infernale qui se resserre implacablement sur le personnage, ménageant quelques montées d’adrénaline et pas mal d’angoisse.
Mais là où le réalisateur est le plus efficace, c’est pour insuffler de l’ambivalence à ce qui aurait pu n’être qu’une énième histoire de fragile jeune femme aux prises avec un dangereux psychopathe. Il nous offre ainsi toutes les raisons de douter de l’état mental de l’héroïne, et ménage le suspense jusqu’au dénouement final, bien plus cruel qu’il n’y paraît.
Film américain de Steven Soderbergh (2018), avec Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah. (hors compétition)
Utoya 22. Juli
Délicat exercice que celui auquel s’est prêté le réalisateur norvégien Erik Poppe, qui reconstitue en temps réel, et en un unique plan-séquence de 72 minutes, l’attaque menée par Anders Breivik contre le camp des jeunes travaillistes norvégiens sur l’île d’Utoya le 22 juillet 2011.
Le film suit Kaja, une jeune fille présente sur l’île, qui tente d’échapper au tueur tout en essayant de retrouver sa sœur. Plus que l’horreur des tirs et les corps qui s’effondrent, le récit se concentre sur le parcours du personnage et les questions auxquelles elle est confrontée. Où se cacher ? Que faire pour aider les autres ? Comment réagir face au danger ? On ne verra jamais vraiment non plus le tueur, hormis sous la forme d’une silhouette fugace, et c’est le son, plus que l’image, qui apporte une dimension anxiogène au film.
Erik Poppe a ainsi fait le choix de la plus grande sobriété, sans pour autant s’exonérer d’une forme fictionnelle (ses personnages sont fictifs et seuls les différents événements sont inspirés des récits des rescapés), voire d’une once de romanesque. Face à cette situation bien connue des amateurs de film d’horreur (un groupe de jeunes gens menacés par un tueur invisible), le réalisateur n’évite pas certains tics du cinéma de genre, et laisse monter, peut-être malgré lui, un suspense forcément ambigu. Ce faisant, il interroge le regard du spectateur et décortique son rapport à ce type d’images qui est à la fois sous l’influence de références de fiction (le cinéma d’horreur et le jeu vidéo) et contaminé par les faits réels qui se sont multipliés en Europe ces dernières années. Il montre comment ce qui était une situation purement fictionnelle est entré de plein fouet dans notre quotidien, rendant tendancieuse, si ce n’est obscène, la « refictionnalisation » de cette réalité.
Film norvégien d’Erik Poppe (2018), avec Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad. 1h 22. (compétition)
Virus tropical
Adapté du roman graphique Virus tropical de Power Paola, ce film d’animation en noir et blanc raconte la vie d’une famille équatorienne constituée d’un père, ancien prêtre, d’une mère qui lit l’avenir dans les cartes et de trois sœurs qui découvrent successivement l’amitié, la rébellion, l’amour et l’indépendance.
Le ton, ironique et franc, et le graphisme, épuré mais évocateur, forment un très joli écrin à ce récit autobiographique qui raconte chapitre par chapitre les grandes étapes de la vie de cette famille « normale », c’est-à-dire dysfonctionnelle mais aimante. La sœur aînée grandit puis s’éloigne, les parents se séparent, l’héroïne connaît sa première expérience sexuelle, puis son premier chagrin d’amour… Et ainsi jusqu’à dessiner subtilement les grandes étapes du cycle de la vie, entre premières fois inoubliables et éternel recommencement.
S’il y a parfois une certaine nostalgie dans la narration, c’est globalement l’humour qui l’emporte, avec un sens certain de l’autodérision et une absence de complaisance qui sonne juste. Santiago Caicedo croque en quelques traits des situations prises sur le vif, tantôt cocasses, tantôt cruelles, et propose une chronique familiale douce-amère qui a des accents universels.
Film colombien de Santiago Caicedo (2017). 1h37. (section Generation 14plus)