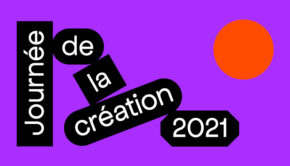L’ASC était à la 40ème édition du Festival du Film court en Plein air de Grenoble
En 1977, un groupe de cinéphiles issus de la Cinémathèque de Grenoble organise un week-end du court-métrage. Certains films sont projetés en plein air, sur un drap de lit, devant des spectateurs assis par terre. C’est l’époque où les salles de cinéma cessent de projeter des courts en première partie et, pour les organisateurs, ces films doivent alors « descendre dans la rue ». Le week-end du court ayant été un succès, il se transforme en festival l’année suivant, toujours avec des projections en plein air qui, encore aujourd’hui, font la singularité de l’évènement. Le festival « numéro 0 » de 1977 est rapidement considéré comme un numéro 1 et on a donc fêté, début juillet 2017, les quarante ans du Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble.
Cet anniversaire a été l’occasion d’évoquer l’histoire du festival, avec une table ronde pleine de souvenirs et une exposition des affiches des précédentes éditions. La rétrospective des films primés fut l’occasion de voir sur grand écran les premiers pas de François Ozon, Cédric Klapisch ou Manuel Poirier (présent cette année comme membre du Grand jury).
Loin de chez eux
Un prix exceptionnel du quarantième anniversaire a été remis à un film de la compétition, Il Silenzio d’Ali Asgari et Farnoosh Samadi. Une petite fille kurde réfugiée en Italie accompagne sa mère à l’hôpital afin de lui traduire le diagnostic du médecin. La maladie est grave, l’enfant osera-t-elle en parler ? L’exil est rendu prégnant par la difficulté à communiquer. Par sa position d’intermédiaire, l’enfant se retrouve face à des responsabilités d’adulte, qu’elle n’est pas prête à assumer. Le style évoque celui des Dardenne, un réalisme rigoureux, qui va à l’essentiel : le personnage est progressivement enfermé dans un dilemme insoluble.
Il était encore question d’exil dans Import d’Ena Sendijarevic qui a reçu le Grand prix du festival. L’approche est cette fois humoristique, de cet humour distancié qu’affectionnent les cinéastes néerlandais (on pense aux Habitants d’Alex van Warmerdam). Le film se présente comme une succession de saynètes souvent drôles, parfois cruelles, et dont le manque de lien entre elles est dans un premier temps désarmant. Les ellipses sont comblées lorsque les différents personnages se réunissent pour regarder un reportage sur la guerre en ex-Yougoslavie : tous sont des réfugiés, en butte à un mode de vie qu’ils n’ont pas encore assimilé. L’absurdité de leur quotidien reflète cette inadaptation. La réalisatrice est née en Serbie et a déménagé aux Pays-Bas durant son enfance, mais la stylisation de son film lui donne une dimension universelle.

Import d’Ena Sendijarevic
Les différences culturelles sont aussi au centre de Ce qui nous éloigne d’Hu Wei (Prix Unifrance), réalisateur en 2013 de l’excellent Lampe au beurre de yak. Un couple de Chinois, en France pour la première fois, est reçu chez deux riches Parisiens et leur fille, d’origine asiatique. La première partie du film est vampirisée par cabotinage d’Isabelle Huppert, dans son emploi habituel de grande bourgeoise stressée. La suite est plus réussie, qui aborde les conséquences de la politique de l’enfant unique et pose la question de la filiation, sans y apporter de réponse toute-faite.
Royal Café de Rémi Caritey et Tenzin Dasel s’intéresse quand à lui à la diaspora tibétaine de Paris. Le film a reçu le Prix d’aide à la création : il est inégal mais, pour le jury, prometteur. Scénariste et co-réalisatrice, Tenzin Dasel va volontairement à l’encontre des clichés véhiculés par le cinéma sur son peuple : il n’est pas question ici du bouddhisme ni de la résistance du Dalaï Lama, mais de petits boulots et de soirées alcoolisées, de solitude et de fraternité. Aussi éloignés que nous semblent les Tibétains et leur culture, leur quotidien ressemble en fait à celui des autres Parisiens : on se retrouve au bar, les femmes fument, l’homosexualité existe. Le café du titre est le lieu où se retrouvent les Tibétains de Paris. C’est là qu’une réalisatrice débutante (double fictionnel de Tenzin Dasel) se rend avec le projet, flou, de faire un film sur les siens. Royal Café est un long court-métrage (40 minutes) car il y au moins deux films en un : la vie de la réalisatrice et le film qu’elle réalise, les scènes qu’elle voudrait tourner et celles qu’elle tourne effectivement, la note d’intention et le film lui-même. Cette démarche réflexive est d’abord surprenante et assez ludique pour rapidement devenir redondante et nombriliste.

Royal Café de Rémi Caritey et Tenzin Dasel
D’autres prix
Dadyaa de Bibhusan Basnet et Pooja Gurung (Prix du jury jeune) se déroule au Tibet mais ne sacrifie pas pour autant aux clichés. C’est un film fantastique, où le mystère et l’angoisse se développent dans de magnifiques paysages naturels, une vallée sauvage progressivement envahie par la brume. L’action se déroule dans un village de montagne abandonné par ses habitants. Ne reste là qu’un couple de vieillards qui confectionne des mannequins afin de remplacer les absents. La vie reprend alors : à l’occasion d’un splendide travelling latéral, les pantins s’animent et jouent de la musique.

Dadyaa de Bibhusan Basnet et Pooja Gurung
Le jury jeune, composés de lycéens étudiant le cinéma, a remis un second prix à l’impressionnant Mare Nostrum de Rana Kazkaz et Anas Khalaf. Le film est en phase avec l’actualité, puisqu’il suit deux réfugiés, un père et sa fille, qui se préparent à effectuer la dangereuse traversée de la Méditerranée. C’est surtout une belle œuvre de cinéma, qui réussit le tour de force de raconter son histoire sans recourir à la parole, lui préférant le choc des corps et l’ambiguïté des comportements. Le décor est également dépouillé : le drame se noue sur une plage de sable fin, surmontée d’une jetée avançant vers la mer, vers l’espoir. Le pays n’est pas nommé, la guerre n’est pas montrée, ni même évoquée, et le soleil qui baigne l’image sert de contrepoint à la violence des évènements.

Mare Nostrum de Rana Kazkaz et Anas Khalaf
Autrement plus joyeux, le Prix du public est allé à la comédie L’avenir est à nous. Le réalisateur Benjamin Guillard y fait preuve d’un sens du timing plutôt rare dans la comédie française. Il est bien servi par le duo comique formé par Olivier Saladin et François Deblock (celui-ci réussissant l’exploit de faire jeu égal avec son camarade, pourtant bien plus expérimenté). Le film, sur fond de crise du logement et de fossé entre les générations, est souvent surprenant, bifurquant soudain vers le road movie et intégrant à la volée de nouveaux personnages cocasses.

L’avenir est à nous de Benjamin Guillard
Bredouilles
L’exilé du temps (Isabelle Putod) n’a pas été primé. C’est regrettable car il s’agit d’une œuvre passionnante, à la fois documentaire et fiction expérimentale. Son point de départ est authentique : en 1962, le spéléologue Michel Siffre passe deux mois seuls sous terre, sans connaitre la date ni l’heure, afin d’étudier la réaction de l’organisme lorsqu’il n’est plus soumis à l’alternance du jour et de la nuit. Cette aventure humaine est reconstituée avec des images d’archive filmées par Siffre lui-même, accompagnées d’une voix off qui lit son journal. À cette base documentaire s’ajoutent des images modernes, objets filmés en gros plans presque abstraits. Ces images en haute définition sont d’une pureté cristalline, qui contraste avec les archives granuleuse et abolit la distance temporelle : le spectateur se sent alors happé par l’image et enveloppé par le son, il se retrouve aux côtés de l’explorateur, ressentant avec lui le froid, la solitude et une complète désorientation. Plusieurs plans de la Lune rappellent que l’expérience de Siffre servit par la suite à la NASA pour prévoir les conséquences d’un séjour prolongé dans l’espace. Ces images du ciel rapprochent surtout L’exilé du temps de la science-fiction (de même que son titre, mystérieux et évocateur) : nous découvrons un monde mystérieux, qui est l’envers du nôtre.
Anna Marmiese, réalisatrice de Lorraine ne sait pas chanter, a collaboré au numéro de L’Avant-scène cinéma consacré aux Demoiselle de Rochefort de Jacques Demy. Son court-métrage est, logiquement, une comédie musicale, qui renverse les codes du genre. Lorraine vit dans un monde où il est naturel de chanter et de danser en toute occasion, particulièrement lorsqu’on est amoureux.se. Dans ce monde, on va au cinéma voir des films « tout parlé », ce qui est le comble de l’artificialité. Lorraine, elle, ne sait pas chanter, ce qui revient à dire qu’elle n’arrive pas à aimer, qu’elle ne sait pas vivre. Elle trouvera sa voix lorsqu’elle aura trouvé sa voie. India Hair est l’interprète idéale de ce personnage renfrogné mais ses partenaires, visiblement choisis pour leurs capacités vocales, sont à la peine dans des scènes dramatiques. Les nombreux numéros musicaux, vifs et amples, n’ont rien à envier à ceux de longs-métrages plus cossus. On apprécie aussi la façon dont la réalisatrice enchante ses décors avec presque rien : il suffit d’affiches colorées collées sur les murs et on se croirait presque à Hollywood.

Lorraine ne sait pas chanter d’Anna Marmiese
Tout aussi charmant est Les rues de Paris ont toujours deux côtés (Laurent Lagarrigue), brève rencontre de deux cyclistes à un feu rouge. Ils se reconnaissent, se sont aimé puis quitté. La beauté du film vient de sa concision : les sentiments et les pensées des personnages passent exclusivement par leurs échanges de regard, sans avoir besoin de parler.
Elles
La force des personnages féminins était l’heureux point commun entre beaucoup des films sélectionnés. On a déjà évoqué le courage des petites filles d’In Silenzio et Mare Nostrum, le chagrin de la mère biologique de Ce qui nous éloigne, les hésitations de la réalisatrice de Royal Café. Ajoutons-y la fraîcheur de La Fauvette (Camille Plagnet et Jeanne Delafosse), collégienne qui joue les Antoine Doinel et sèche les cours pour trainer dans la nature. Dans La Leçon de Tristan Aymon, une jeune femme veut apprendre à faire de la moto et déjoue les clichés sexistes associés aux grosses cylindrées, objets de pouvoir viril et de séduction. Créatures (Camille Mol) et Blind Sex (Sarah Santamaria-Martens) sont deux récits d’émancipation sexuelle. L’adolescente de Créatures découvre son pouvoir de séduction, qui lui permettra de satisfaire ses désirs. Certaines scènes du film sont comme suspendues, à l’image d’un personnage encore en devenir. Blind Sex est un film joyeusement hédoniste, qui confronte un aveugle, ignorante de son corps, à un groupe de nudistes à la sexualité libérée. Il a reçu la coupe Juliet Berto, prix remis par les sélectionneurs du festival à un film présentant, justement, des femmes hors du commun.




La fauvette de Camille Plagnet et Jeann Delafosse / La leçon de Tristan Aymon / Créatures de Camille Mol / Blind sex de Sarah Santamaria-Martens
Folies animées
Le dessin animé Pépé le morse de Lucrèce Andreae (Prix Unifrance ex aequo) aborde le deuil de façon peu conventionnelle : une famille dysfonctionnelle va à plage pour rendre un dernier hommage au grand-père, amateur de farniente récemment décédé. La grand-mère est dingue, les enfants sont insupportables, la mère râle. Le trait est acéré, à la fois réaliste (les décors) et plus caricatural (les personnages). Cet entre-deux est propice aux altérations de la réalité, dont les protagonistes font faire l’expérience. Sur la plage s’érige un monument funéraire composé de déchets : on peut y voir une métaphore du film, trivial dans son contenu mais sincère dans son émotion.
L’Ogre de Laurène Braibant a quand à lui reçu le prix de la presse, doté entre autre d’un abonnement à L’Avant-scène cinéma. Un homme obèse se rend à un diner mondain et, se laissant emporter par son appétit insatiable, il grossit jusqu’à prendre des proportions cosmiques. On pense à une scène d’anthologie du Sens de la vie des Monty Python, mais la chute de l’histoire est différente, moins potache, plus poétique. Il y a aussi du Rabelais dans la façon dont Laurène Braibant transforme l’obscénité (manger, régurgiter, déféquer) en poésie, jusqu’à donner aux excès du personnage une dimension métaphysique. Le film est sans parole mais son langage est pourtant fleuri, le dessin donnant corps à des métaphores visuelles : chier une baleine, être gros comme un astre. Le précédent court-métrage de Laurène Braibant décrivait de façon impressionniste un combat de sumo. Elle prolonge dans L’Ogre ce travail autour de la rondeur et du gigantisme : l’animation permet de déformer les corps, de leur donner une élasticité impossible à obtenir en live (la scène où l’ogre se fraie un passage dans une foule compact, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, est un parfait exemple des possibilités burlesques du cartoon). Alors que Sumo était en noir et blanc, la réalisatrice fait dans L’Ogre un usage éclatant de la couleur : l’ogre est d’abord présenté comme un individu complexé et terne mais des couleurs vives envahissent l’image à mesure qu’il s’empiffre, se singularise des autres convives et s’accepte tel qu’il est.

L’Ogre de Laurène Braibant
Si ce menu vous a mis en appétit, profitez d’une séance de rattrapage à la cinémathèque française, où certains films de la compétition seront rediffusés le lundi 11 septembre 2017.
SYLVAIN ANGIBOUST
Un grand merci à toute l’équipe du Festival !
Le palmarès complet du Festival c’est par ici